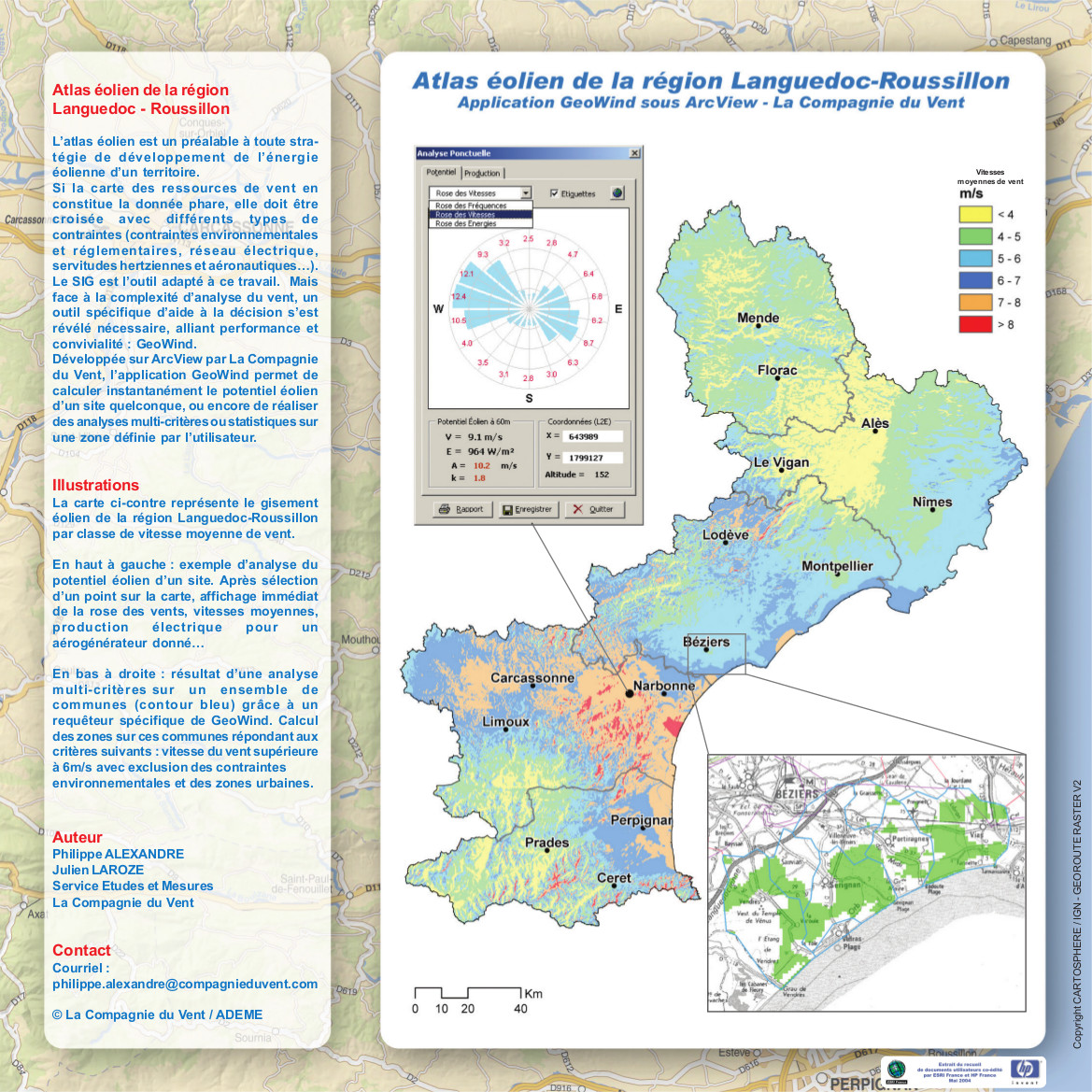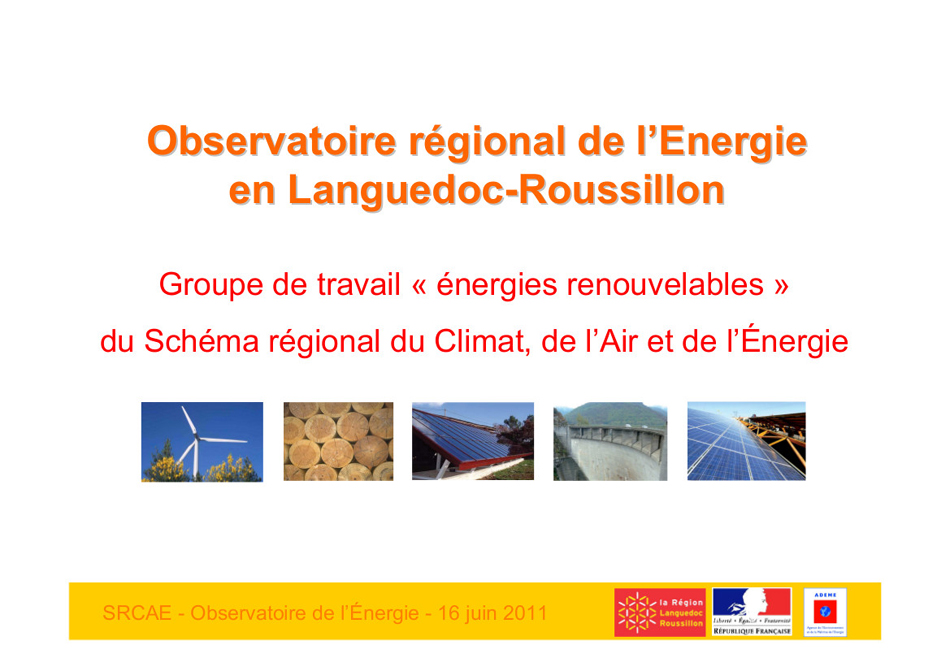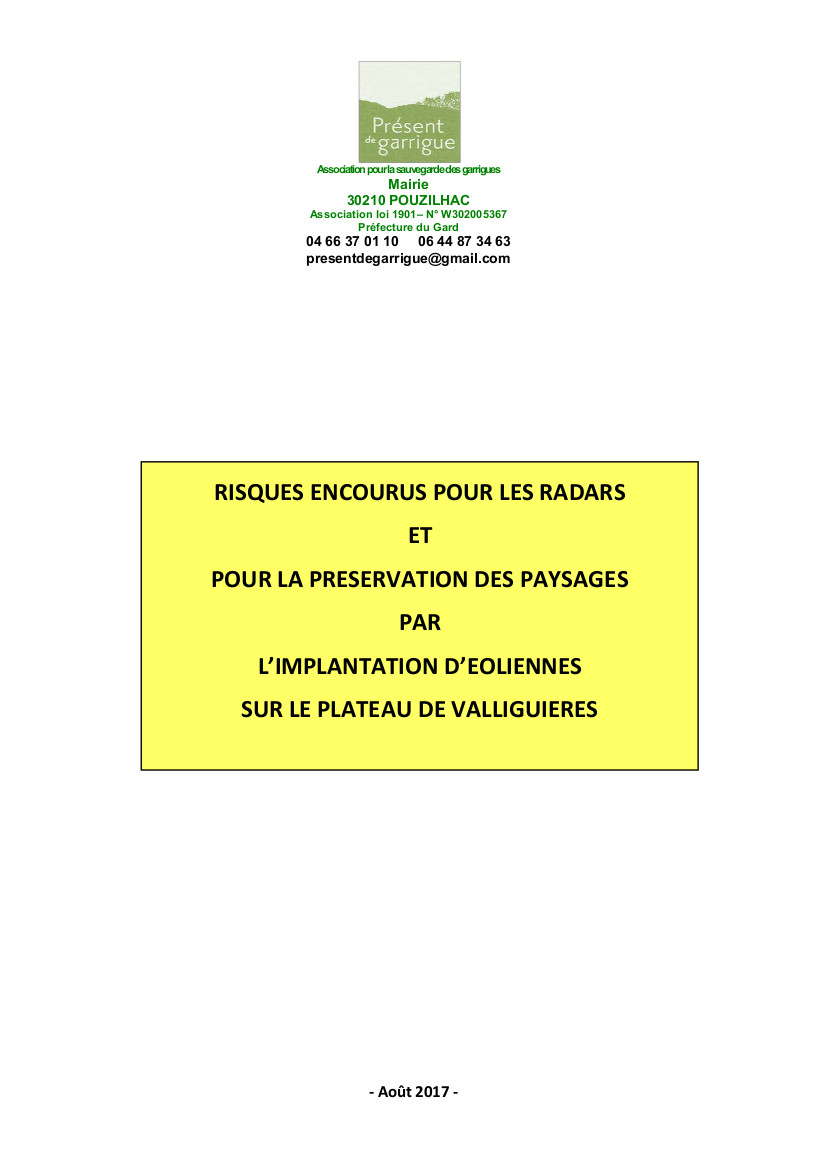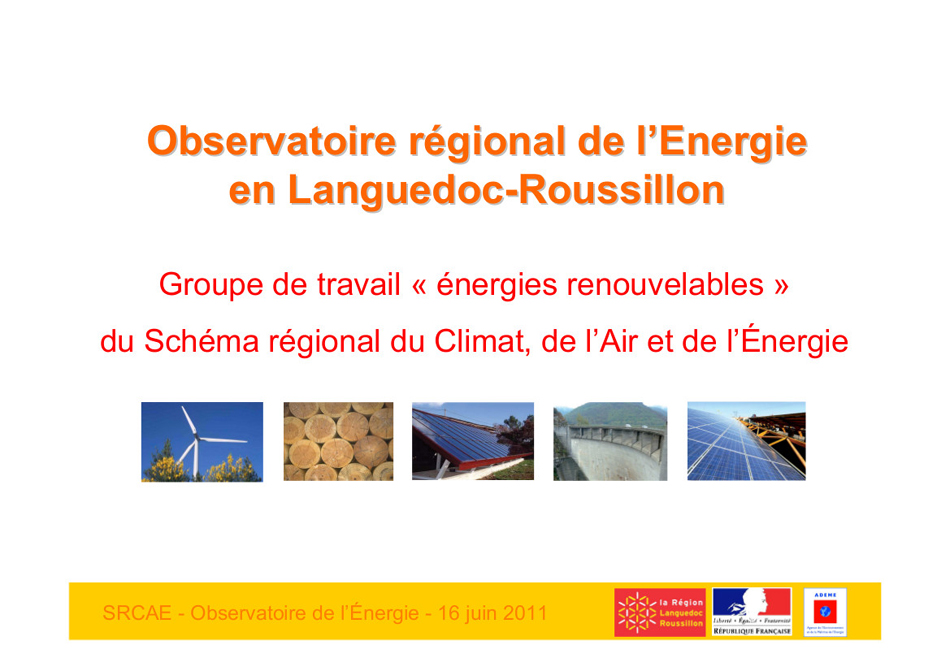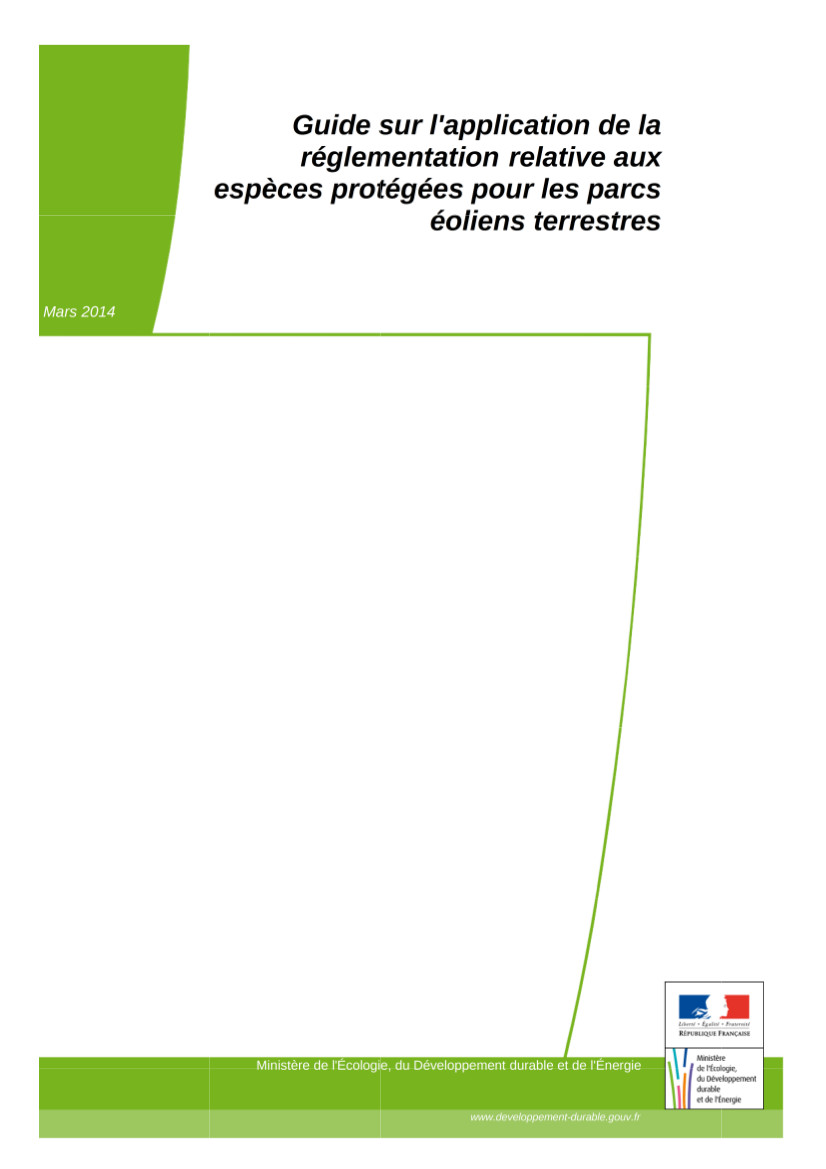En
construction
La consultation
PPE: un tissu de contre vérités !
Mis à jour : 15 févr. 2020
La consultation de la PPE en version révisée
recèle de telles contre-vérités sur la
production d’électricité éolienne
terrestre, qu’un citoyen un peu averti aurait mauvaise
conscience de ne pas y apporter quelques éléments
rectificatifs.
A- L’ORGANISATION INDUSTRIELLE DU SECTEUR
… « Le parc français atteint
15 075 MW soit environ 7 500 mâts. Au cours de l'année
2018, 150 parcs éoliens représentant une puissance
de 1,47 GW ont été raccordées au réseau
»…
C’est une présentation est simpliste.
La production de l’électricité d’origine
éolienne est assise sur deux privilèges :
• Une obligation d’achat par EDF de
l’électricité produite, quand elle est produite,
que le réseau soit demandeur de puissance ou non,
• Des tarifs de rachat fixes pendant des
durées très longues après raccordement
; ces tarifs restent fixes sur très longue période
de 15 à 20 (compris entre 65€ et 82 € à
68 €/MW soit 25 à 50% au- dessus du prix de marché.
Ces privilèges sont exorbitants : Imagine-t-on
quelqu'un qui produit une marchandise quand ça lui chante,
qui l’écoule quelle que soit la demande du marché
mais surtout qui la vend pendant 15 ans à un tarif fixé
à l’avance, supérieur de 25 à 50%
aux prix du marché...
Avec ces privilèges inchangés depuis
20 ans, un modèle économique a structuré
à long terme l’organisation du secteur de production.
En ignorant cette organisation, les recommandations de la Consultation
sont essentiellement des vœux pieux.
Les 7.500 mâts sont répartis sur
1.365 sites (5,5 éoliennes par site) d’une puissance
moyenne de 11 MW. 150 sites raccordés en 2018 ont une
puissance inférieure à la moyenne nationale (9
,8 GW) ; ce qui conforte la tendance observée de la multiplication
des sites de faible puissance :
• 49,53% des sites ont une puissance comprise
entre 18 mW et 10 mW
• 40,72% des sites ont une puissance inférieure
à 10 mW
La puissance de la quasi-totalité des projets
en instruction est inférieure à 18 mW ; ces sites
comportent moins de 6 mâts. Ils évitent donc d’éviter
la procédure d’appel d’offre et bénéficient
de tarifs de rachat garantis sur 20 ans (74 €/MWh).
La suite
: Michel
Faure, Collectif Énergie Vérité.
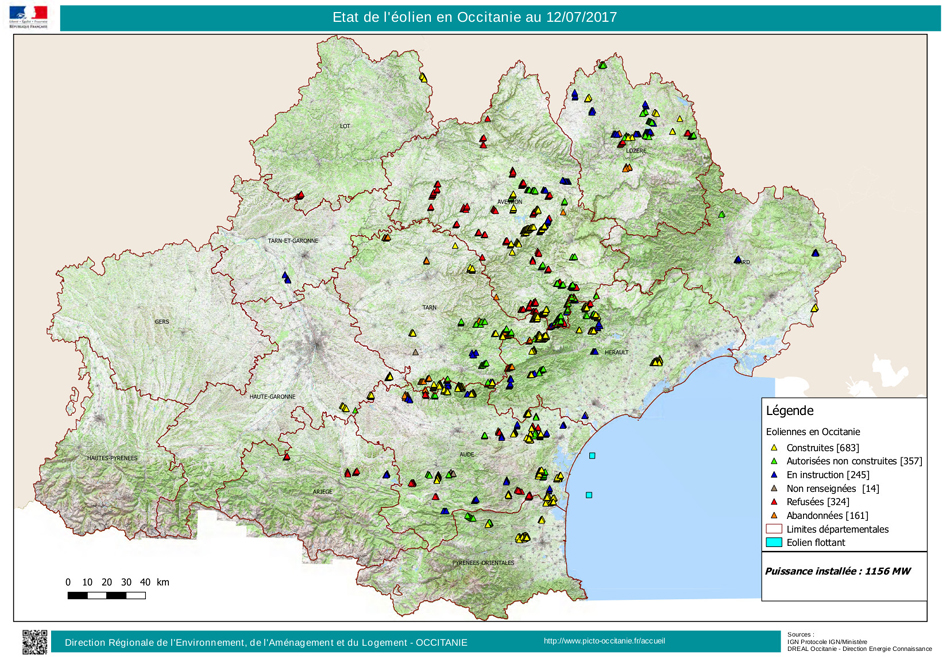
Cliquéz
sur cette image poue accéder à une meilleure définition

Eolien et biodiversité
: prise en compte des enjeux relatifs à la biodiversité
dans le cadre réglementaire français
Michel PERRET1
Ministère de la transition écologique et solidaire,
direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature,
direction de l’eau et de la biodiversité. michel-m.Perret@developpement-durable.gouv.fr
Résumé
Les
parcs éoliens terrestres sont susceptibles d’avoir
des effets sur la biodiversité, en particulier sur certaines
espèces de faune sauvage telles que les oiseaux et les
chiroptères.
Les
réglementations internationales, européennes et
nationales ont pour objectif de prévenir et de maîtriser
de tels effets et leur bonne application est de nature à
ce que le développement de ce secteur de production d’énergie
soit conciliable avec la protection du patrimoine naturel.
En particulier,
les dispositions propres aux espèces protégées
et au réseau Natura 2000 visent à assurer le maintien
et le cas échéant le rétablissement, dans
un état de conservation favorable, de certaines espèces
et de certains habitats naturels et les projets doivent se conformer
à cet objectif environnemental clé.
Fondé
sur les principes de la séquence « éviter,
réduire et compenser » les impacts des projets
sur les milieux naturels, le cadre réglementaire national
qui s’applique aux parcs éoliens terrestres engage
à une planification appropriée des projets et
prévoit un régime d’autorisation administrative
de chaque projet, désormais constitué par l’autorisation
environnementale telle que prévue par le code de l’environnement
Pour
satisfaire à ces objectifs réglementaires et en
particulier aux exigences relatives au bon état de conservation
des espèces et des habitats naturels, les porteurs de
projets doivent caractériser, selon les meilleures techniques
disponibles, les effets de leurs projets sur la biodiversité.
Ils doivent appliquer, d’une manière proportionnée
aux enjeux, les mesures d’évitement et de réduction
de leurs impacts. Si malgré l’application de telles
mesures, subsistent des effets résiduels significatifs
sur les espèces et les habitats naturels, les projets
ne pourront être autorisés que si des mesures de
compensation permettent de rétablir les situations biologiques
dégradées.
Une
fois autorisés, les parcs éoliens terrestres doivent
faire l’objet d’un suivi environnemental permettant
de s’assurer que les conditions de fonctionnement sont
bien de nature à répondre aux objectifs assignés
par les réglementations.
La
suite