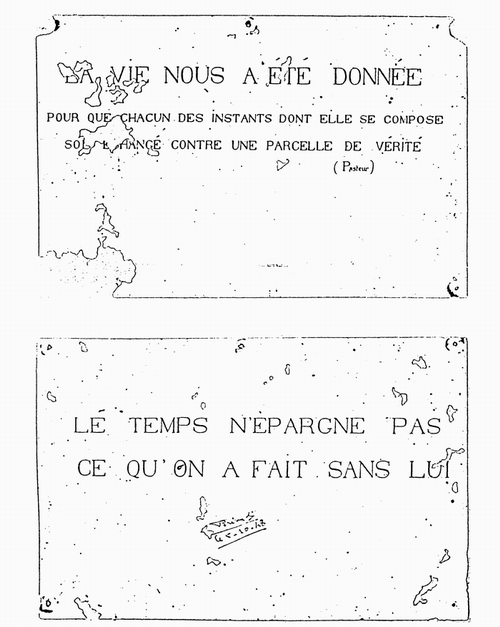![]()
La
tempête des derniers jours de1999 a souligné le manque, ressenti dans le passé
par de nombreux forestiers, d’un stade d’expérimentation sur le terrain, de
transfert entre la recherche sylvicole – botanique, en particulier – et la
pratique des plantations et des reboisements. En préface à la réédition de
la notice nécrologique que Charles Flahault avait consacrée à Georges Fabre,
dans le volume XL, 1912-13, du Bulletin de la Société d’Etude des Sciences
Naturelles de Nîmes et du Gard, rééditée en 1997, M. Valdeyron, professeur
honoraire à l’INA P.-G., demandait : pourquoi les résultats des expériences
tentées à la fin du 19e siècle ont-ils été négligés par les reboiseurs du
massif de l’Aigoual ?
A cette question, posée par l’agronome,
c’est l’historien qui a vu des éléments de réponse dans l’itinéraire
scientifique de Charles Flahault. Phytogéographe se voulant cartographe, il
paraît, en effet, possible que ce dernier ait trouvé dans sa collaboration
avec Fabre, l’échelle
convenant à sa démonstration lorsque, retournant à une vocation première, il
est devenu « jardinier ».
Jean-Claude
MOUNOLOU
Membre de l’Academie d’Agriculture de France
Membre de la Commission Nationale de
Génétique Forestière
Regarde, promeneur !
Regarde ce ravin qui déverse à grand fracas vers la mer, au printemps,
les eaux de la fonte des neiges. C’est
un livre ouvert sur deux pages, qu’il montre aux Basses Cévennes et à cette
mer toute proche. Ces deux pages, lis-les avec elles.
Penche-toi sur la page de ta gauche, c’est l’Europe. Les arbres plantés
il y aura bientôt cent ans sont souvent beaux mais ils ont par trop un air de
famille. Ils se sont reproduits mais leurs descendants, fruits d’unions
toujours incestueuses, ressemblent à tous ces parents à la fois. C’est que
l’Europe est petite et pauvre en formes. Elle n’a donné à ses forêts que
ce qu’elle a pu, ce qui lui resta, il y a quelques dizaines de milliers
d’années, lorsque beaucoup d’espèces végétales, fuyant les froids qui sévissaient
sur notre planète et butant contre la Méditerranée, ont péri. Beaucoup
risquent fort de nous manquer, maintenant.
Sur la page à ta droite, ce sont les grands espaces et les hautes
montagnes de l’Ouest, les Andes et les Rocheuses – et l’Himalaya n’est
pas si lointain. Les plantes qui peuplaient leurs sommets, plus élevés, ont pu
trouver à se réfugier dans les basses vallées ou même s’enfuir vers les
immensités du Sud. Les arbres de toutes tailles, de toutes formes, de toutes
valeurs d’utilisation, aussi, ont offert à l’homme leurs possibilités
multiples. Il a pu y choisir ces espèces magnifiques aux ports majestueux, ce
Sapin noble tout près de toi, resté inconnu des reboiseurs, ces Douglas trop
connus mais qui ont, au moins, le mérite de l’être. D’autres encore
auraient dû être essayés hors des collections. Ils seraient peut-être prêts,
maintenant, à remplacer les bois exotiques importés d’Afrique lorsque les
forêts en auront été épuisées par l’exploitation minière des néo-colonisateurs
et qu’il faudra en attendre un renouvellement bien problématique.
Lis ces pages ouvertes, promeneur et regarde. Rentré chez toi,
n’oublie pas cette leçon superbe et parles-en à tes enfants, à tes amis,
s’ils ne sont pas aujourd’hui avec toi. Un savant a su y dire la géniale
pensée d’un forestier qui fût aussi un prophète. La tempête a épargné ce
pays et ces arbres restent pour en témoigner. N’est-ce pas un signe du destin ?
De l’Aigoual, en ce siècle nouveau, Georges Fabre et ceux qui, résolus à ne
pas abandonner ce pays, l’aidèrent de tout leur cœur, diront à la France,
grâce à Charles Flahault, leur ami, comment refaire une forêt plus belle.*
*
C’est à 400 m de l’entrée de l’Hort de Dieu, à l’endroit où
le « Chemin Flahault » passe au-dessus du « Ravin de Thunberg »
que le promeneur est invité à se situer. Le plan au 1/2 500 figurant à la fin
de cette brochure lui permettra de le faire aisément et, de là, de comprendre
la structure de l’arboretum.
Ma première rencontre avec Charles Flahault date du début de 1920. Dans
une salle à manger, nous sommes assis, mes parents et moi, avec quelques
personnes, quatre au plus, probablement, toutes de taille plutôt petite.
L’une d’elle, un homme, portant peut-être une courte barbe, trace avec son
couteau une croix sur le dos d’un pain.
Les Flahault étaient gens d’usage et de tradition. Accueillir l’étranger,
les réfugiés que nous étions devenus, faisait partie des devoirs de qui avait
les moyens de le faire – même si ces moyens se trouvaient laminés par l’économie
des lendemains de la guerre. J’ai toutefois quelques raisons de penser que mes
parents occupaient une place spéciale dans l’affection que le Maître portait
à ceux de ses élèves qu’il jugeait sérieux.
Pour ceux, assez nombreux, qu’il ne jugeait pas sérieux, il ne leur
portait aucune affection. Il était le seul des professeurs de la Faculté des
Sciences à coller sans pitié, par une mauvaise note en botanique, les nombreux
étudiants du « PCN » dont il estimait les réponses insuffisantes.
Leur manque d’intérêt pour la discipline où s’étaient illustrés, avec
Rabelais et bien d’autres, les élèves et les successeurs de Rondelet ne leur
méritait pas, disait-il, l’honneur d’être diplômés de la Faculté de Médecine
de Montpellier. Collés et reçus en étaient parfaitement d’accord pour le
trouver plus tatillon que ne l’autorisait la situation examinée avec
objectivité. Le monôme par lequel ils manifestaient leur ressentiment
parcourait régulièrement la ville, après la proclamation des résultats, tous
criant sur l’air des lampions : « Conspuez Flahault ! ».
Les étudiants avaient alors, eux aussi, de l’usage.
Charles Flahault, pour sa part, était incontestablement sérieux. Sérieux,
sévère parfois. On l’a dit bon. Sans doute l’était-il mais avec une
totale discrétion et il n’est donc pas possible de savoir au juste avec qui
il l’était. Pour le reste, tous ceux qui l’ont vraiment approché, surtout
dans l’épanouissement de sa cinquantaine, en étaient d’accord : amical,
d’abord mais aussi spirituel, gai jusqu’au goût de la farce, il réservait
tout cela à ceux qui partageaient ses valeurs et dont il estimait qu’ils le méritaient,
à ceux qu’il jugeait … sérieux. Il en tirait
autorité et même séduction. Il n’était pas du tout le « papa gâteau »
parfois présenté maintenant, encore moins le botaniste miteux méchamment
brocardé par Gide. Il n’eut pas de troisième fille et ne l’aurait pas
baptisée d’un prénom de fleur ridicule..
Des anecdotes nombreuses et des citations plus authentiques les unes que
les autres circulaient à son sujet. Je ne sais quel crédit il faut accorder à
celles qui ont voulu témoigner de sa sévérité – et qui ne semblent pas lui
avoir survécu. Quelques-unes ont bercé mon âge tendre. Je les dois à ma mère,
qui les connut, sans doute, par les années très studieuses de son certificat
de Botanique mais surtout par les étés où
elle fût, du 1er août à la fin septembre « la
gardienne du foyer » à l’Hort de Dieu.
C’est d’elle que j’appris l’histoire du facteur dont Flahault
exigeait le passage quotidien au laboratoire de montagne, ce qui demandait au
fonctionnaire d’allonger un trajet malcommode : « S’il n’a pas
de courrier à me donner, j’en ai à lui remettre ». Parallèlement, le
facteur trouvait à son passage un verre d’un vin qui lui était réservé, le
seul existant au laboratoire. Il était sans doute déjà passablement alcoolisé
lorsque, entrant un jour au chalet et y trouvant ma mère seule, il entreprit de
lui conter fleurette -- à quoi mit heureusement fin l’arrivée de mon père, venu
à bicyclette pour une visite de week-end. Personne n’osa porter l’affaire
devant le Maître mais il existe, pour les botanistes comme pour les autres, une
justice immanente qui voulut que le facteur fût surpris posant des collets. Sa
révocation pure et simple ne demanda aucun délai.
Je pense que c’était bien de sévérité et de rigueur – mais non de
dureté – qu’il s’agissait, lorsqu’il fit une horrible scène à une
promeneuse qu’il surprit cueillant une branche fleurie sur les fameux
rhododendrons voisins du laboratoire – le seul péché qu’il devait juger
mortel. Ce n’est que le sort qui voulut que la promeneuse souffrit du cœur.
Elle en serait morte et son mari, dit-on, se procura une arme pour la venger,
sans que nous sachions à quoi la botanique doit de ne pas avoir été privée,
à cette occasion, de l’un de ses serviteurs les plus fidèles.
Au laboratoire, la rigueur régnait pour nombre de détails de la vie
courante. Coté équipement, le port obligatoire de chaussures de montagnes exagérait
probablement le risque de morsures par les vipères – encore qu’il ait fallu
attendre les années 1970 pour que, les arbres s’étant développés, ces
reptiles abandonnent définitivement la place, comme de nombreux autres éléments
de la faune et de la flore qui constituaient la richesse biologique de
l’endroit. Coté « mode de vie », la rigueur se manifestait dès
le matin par l’heure du début des activités ; c’était cinq heures,
la même que celle qui réglait le début des travaux pratiques lorsque commençaient
les « beaux jours » de l’année universitaire. Qui penserait à
une erreur de l’historien se souviendra qu’il s’agissait alors du temps
moyen de Greenwich. Même ainsi, toutefois, d’aucuns pouvaient parfois en
regretter de ne pas avoir choisi d’autres formes de villégiature :
l’orientation si écologiquement exceptionnelle de l’Hort de Dieu amène le
soleil à ne s’y montrer, en été, que deux heures plus tard. Restait la
toilette, pour laquelle rigueur et confort s’opposaient sans doute le plus
durement. Pourtet – qui devait le tenir de Guinier -- me montra un jour, dans
le torrent, un creux de rochers qui passait pour avoir été la baignoire
officielle du Maître et il n’existait sans doute pas d’autre moyen de procéder
à des ablutions de quelque généralité.
Je ne crois pas devoir insister sur la rigueur par laquelle Flahault
commençait, celle qu’il s’appliquait à lui-même, puisque c’est une
constante de la légende qu’il a laissée parmi ses amis et, plus encore, ses
parents. L’habitude de la marche à pied alla cependant jusqu’à lui faire
oublier les limites d’une résistance physique qui prenait d’abord son
origine dans la volonté nerveuse. C’est sans doute trop volontiers
qu’il choisissait de monter de Valleraugue par le sentier « des 4000
marches ». Il n’y fallait guère que deux heures mais certains passages
sont pénibles, surtout si l’on veut forcer quelque peu l’allure. Parvenant
au chalet, un jour de saison avancée, il s’écroula devant la porte. Là
encore, on peut se demander ce qui se serait passé sans la présence opportune
d’ouvriers occupés à des plantations. Il est probable que ni sa frugalité,
ni une complexion finalement plutôt frêle n’auraient dû lui permettre les
efforts auxquels il se soumettait parfois, dans son désir de donner l’exemple
de l’énergie dans le travail, peut-être aussi de la volonté d’aller, à
tous égards, jusqu’au bout du possible.
Pendant la douzaine d’années qui suivit notre première entrevue, je
le revis peu. Nous étions partis au loin et, au retour, ma
mère ne chercha pas à resserrer ces relations : elle devait
estimer qu’elle n’était plus en cause et que, pour moi, je n’avais pas
encore présenté les garanties de sérieux
indispensables. Elle me poussait seulement à entretenir toujours, avec le Maître,
une correspondance de vacances qui me valait, de sa part, de très soigneuses
suggestions de promenades.
Mon succès au concours de l’agro vint enfin me rendre « présentable ».
Quelques jours après mon retour de Paris, où j’étais allé passer l’oral,
elle me donna ce qu’elle ne me donnait que rarement, un ordre. « Tu dois
aller voir Monsieur Flahault » -- par elle, je ne l’ai jamais entendu
appeler autrement. J’obtempérais sans ennui : il était, pour moi, un
familier, invisible mais quotidiennement présent. Depuis sa retraite, prise à
75 ans, selon la règle qui s’appliquait alors aux membres de l’Institut, il
était interdit d’Université et se plaignait amèrement d’être privé de
moyens de travail, de sa documentation, surtout. Il n’y avait pas de CNRS pour
abriter ceux qui ne se résolvent pas à rompre brutalement avec leur domaine de
pensée, ne serait-ce que dans les détails de la vie courante. Guinier eut
assez d’intelligence et d’affection pour lui pour comprendre que Flahault
restait et resterait jusqu’à sa mort une chance pour la forêt. Il obtint sa
quasi-intégration dans le service départemental, à la Commission Départementale
de Reboisement.. C’est dans le petit bureau qui lui était réservé dans
l’immeuble de la Rue de la République que j’allais le voir, par un matin de
ce mois de juillet. Il avait alors 81 ans.
Je négligeai de me présenter et il n’insista que juste ce qu’il
fallait pour que je comprenne qu’il était excusable d’hésiter à me
reconnaître alors qu’il avait quelques raisons de ne pas m’avoir en
permanence à l’esprit. Il me fit asseoir à sa gauche, tout près de lui –
peut-être se méfiait-il de son ouïe. A ma demande polie sur son état de santé,
il tint à me dire qu’il était toujours en état d’herboriser « mais
il faut qu’on m’amène à pied d’œuvre, ajouta-t-il – et je ne peux pas
m’asseoir, sinon, je ne peux plus me relever ». La conversation se déplaça
ensuite rapidement en direction des Cévennes et des Causses et des promenades
qu’il m’avait conseillé d’y faire. Sur ce point, je le trouvais pourtant
moins enthousiaste que je ne le pensais. Il regrettait évidemment l’abandon
de l’Hort de Dieu. De l’Espérou, distant de neuf kilomètres et où, chaque
dimanche, il allait autrefois – à pied, bien sûr -- entendre la messe et
prendre ensuite son petit déjeuner au presbytère, il me dit seulement, en
appuyant sur la première syllabe : « Il y a des ph-phonographes, là
haut, maintenant », ce que j’avais, du reste, constaté moi-même. Le
lever du soleil à l’Aigoual n’eut pas davantage son approbation car
c’est un beau spectacle partout. Je ne pouvais qu’être du même avis,
d’autant que, n’ayant pas encore habité l’Hort de Dieu, je ne savais pas
que le soleil s’y lève trop tard pour y être admiré au lever. Nous passâmes
aux Causses et je crus bien faire de lui parler de ma visite à l’Aven Armand.
« Etes-vous allé à l’Aven Armand, Monsieur, demandai-je ? Non, me
répondit-il et je n’irai jamais ». Je baissai discrètement le nez. Je
supposais qu’il faisait état de quelque difficulté liée à son âge mais il
ajouta, après un temps de respiration : « Je n’aime pas les
lampions de couleur ». C’était, cette fois, sur le « pas »
qu’avait porté l’accent. Il est exact qu’il y avait beaucoup de lampions
à l’Aven Armand. Quant aux couleurs, elles changeaient toutes les quatre
minutes.
Je me souviens mal de la façon dont la conversation prit ensuite un ton
plus général -- je dirais,
aujourd’hui, philosophique – s’orientant vers la vie des espèces végétales
plus que vers leur identification. Sans doute sans intention bien précise,
peut-être pour revenir poliment sur l’une de ses phrases, je prononçais le
mot d’adaptation. Il posa sa main sur mon poignet droit. Le ton se fit grave.
« L’adaptation n’existe pas, dit-il ». Une nouvelle et dernière
fois, je me trouvais contesté. Dire que j’en fus bouleversé serait pour le
moins exagéré. Je serais même plutôt porté à m’étonner d’avoir gardé
la phrase en mémoire.
Avant de clore l’entretien, il me demanda : « Etes-vous
croyant, mon enfant ? » Je me lançai dans des explications
manifestement plus compliquées qu’il ne lui était nécessaire. Il
m’interrompit par un geste apaisant des deux mains, plutôt rapide : « Bien,
bien… ». Je crus comprendre qu’il voulait seulement s’assurer que ma
position n’était pas trop simple et que je l’avais pleinement rassuré. Au
moins sur ce point, il ne m’avait pas désapprouvé
Deux ans plus tard, quelques semaines après sa mort, je trouvai, avec la
génétique, un emploi pour ma curiosité d’une biologie autre que seulement
descriptive. Je lus les livres de Guyénot, dont le dernier, l’« Evolution »,
me ramena à cette conversation finissante. Flahault, le seul savant qui ait
fait partie de mon horizon familier, à qui mes parents et leurs amis avaient
rendu un véritable culte, fait de respect et d’affection, plus, peut-être,
que de savoir, m’avait, en quelque sorte, tenu sur les fonts baptismaux de
l’évolutionnisme. Ce n’est que plus tard que l’on me fit noter que cette
sorte de testament, cette phrase énoncée avec presque une nuance de regret
dans la voix, à travers la diction parfaite, ne sonnait pas sans une certaine
ambiguïté. Comme tous les grands enseignants, Flahault aimait provoquer pour
orienter vers une pensée juste. Le mot d’adaptation, tel qu’il
l’employait, était pourtant maladroit. Je voulus y voir les effets d’une
adhésion tardive à une biologie plus moderne, au regret d’avoir perdu du
temps à une forme de pensée périmée. Je pense maintenant que je me trompais
Deux
lettres
Bachelier ès Lettres à 20 ans, en 1872, Charles Flahault décide de se
consacrer à l’horticulture et entre pour cela au Muséum d’Histoire
Naturelle à Paris, comme élève jardinier : c’est, alors, la marche à
suivre normale. C’est aussi une vocation. Pourtant, ses professeurs remarquent
vite son ardeur au travail, son intelligence aussi, bien sûr. Ils exigent une réorientation
vers un avenir plus brillant. L’horticulture, profession sympathique, certes,
ne saurait être considérée comme suffisamment noble pour convenir à qui est
indiscutablement un intellectuel de valeur. L’intellectuel s’incline
respectueusement. Il passe en 1874 – après un an de service militaire dans
les chasseurs à pied – son baccalauréat ès sciences et va commencer, à la
Sorbonne, la préparation d’une licence de Sciences Naturelles, en même temps
qu’il travaillera au laboratoire de son concitoyen bailleulois, Van Tieghem,
à l’Ecole Normale Supérieure. Le long d’un itinéraire universitaire éclair,
il sera licencié en 76 et docteur ès Sciences en 78.
|
|
|
Quelqu’un, pourtant,
n’en est pas – ou pas seulement – satisfait. Madame Flahault mère, férue
de botanique et de floriculture, avait défendu l’entrée au Muséum contre
son mari. La Sorbonne plonge la sainte personne dans la terreur : Une stricte éducation
religieuse de ses enfants a toujours eu pour elle la première importance. Or,
ce nouveau tuteur de fait, ce Monsieur Van Tieghem, n’a pas, à Bailleul, une
telle réputation que l’autorité qu’il prend sur son fils la rassure sur
les dangers qu’il court de perdre son âme à la recherche d’une douteuse vérité
scientifique.
Le 30 avril 1874, une lettre entreprend de la tranquilliser. Entre le
« Chère maman » figurant sous la date et le « Votre fils qui
vous aime », précédant une signature complète, très paraphée, les
deux premières pages donnent des nouvelles et exposent divers besoins, croquis
à l’appui. Suit une demi-page où se trouve exposé le témoignage d’une dévotion
mariale se situant à la limite de la crédibilité. Presque tout le reste doit,
je crois, être cité intégralement.
« Vous me demandez
encore si je vois des Pères Jésuites. Le Père Clair (de Lune) – sic,
ndlr – qui était l’an dernier mon confesseur, est parti et j’ai dû
chercher quelqu’un d’autre. J’ai trouvé le P. Topin, ancien préfet
de la Rue des Postes, qui est un peu endormi mais qui
fait mon affaire momentanément, jusqu’à ce que je sois bachelier sans doute
– les italiques sont miennes, comme par la suite dans ces citations, ndlr.
Je vois aussi, tous les dimanches, le Père Plainemaison … J’ai dû
laisser, pour le moment, la Conférence de saint Vincent
de Paul, autant parce que je manque de temps que parce que je manque d’argent.
« Quant à ce que vous me dites de M. Van Tieghem, j’en ai écrit
très longuement à Evariste – le frère aîné centralien, ndlr – et
je ne serais pas fâché que vous lisiez la lettre que je viens de
lui écrire il y a deux jours, n’ayant pas le temps de vous répéter
absolument tout ce que je lui ai dit. Je résume ma pensée à son sujet en vous
disant que je crois M. Van Tieghem l’un des meilleurs hommes de sa génération,
de ceux, du moins, qui n’ont pas eu le bienfait d’une éducation
essentiellement catholique. M. Van Tieghem n’est pas un catholique militant,
je crois qu’il pratique mais n’en suis pas sûr mais qu’il pratique ou
non, il n’a fait jusqu’ici par tous ses écrits et son enseignement que du
bien à la religion et ce bien a été
très grand et augmentera avec la renommée de M. van Tieghem qui, considérant
la chose au seul point de vue scientifique, a travaillé avec plus de succès
qu’il n’avait été fait jusque là à renverser le Darwinisme, le système
philosophico-scientifique matérialiste par excellence – mes
italiques, comme plus bas, ndlr. Ne pensez-vous pas qu’avec l’éducation
laïque qu’il a reçue, M. Van Tieghem n’ait pas beaucoup plus de mérite
que beaucoup d’hommes qui ont fait des études catholiques et qui suivent par
routine et sans intelligence la voie qu’ils ont devant eux ?
« Enfin, quoi qu’il en soit, je me tiens sur mes gardes et ne vis
pas sans conseil mais, je vous le répète, les hommes sains, spiritualistes
considèrent M. Van Tieghem comme leur homme. (Pour le détail de cette
discussion, je vous renvoie à la lettre d’Evariste). Quant à l’opinion des
personnes qui voudraient voir mon professeur plus chrétien, elle est fondée
peut-être sur ce que M. Van Tieghem déteste Louis Veuillot – cf. PLI ndlr
– qui est maintenant considéré par tous les catholiques comme faisant un
tort immense à la religion, de ce que, aussi, il dit quelquefois tout haut
que le clergé français manque d’instruction, que le clergé ne travaille pas
assez et n’êtes vous pas de son avis ? De ce qu’il n’est pas légitimiste ?
Qui lui a appris à aimer la royauté [si] ce n’est pas son beau-père qui a
servi le roi du Piémont contre la principauté de l’Italie …? »
Deux ans passent. C’est peu pour terminer une licence qui en demande
normalement trois, un an par certificat, zoologie, botanique, géologie. Les
trois sciences sont presque également intéressantes mais le climat est détestable.
Le corps professoral évoque désagréablement le panier de crabes. Le
professeur dont Flahault fréquente le laboratoire à la Sorbonne,
Milne-Edwards, est à couteaux tirés avec un collègue, comme lui spécialiste
de l’étude des mollusques : le professeur Baron de Lacaze-Duthiers, qui
prend l’étudiant pour une taupe de son adversaire et trouve le moyen final
pour le déconsidérer. Le 14 janvier 1876, une lettre nous l’indique.
« …ce souvenir sera remplacé par les calomnies qu’on lui
a dites sur mon compte. Il me considère comme Darwiniste etc. etc.. Moi,
Darwiniste, mon Dieu ! Je ne
l’aurais pas cru s’il ne me l’avait pas dit… »
Récemment fût retrouvée, datée du 18 mars 1905, une lettre « à
la plus tendre des mères », sobrement signée Charles. J’en donne ici
un extrait, essentiel pour mon propos.
« …vous vous inquiétez de Lamarck et de Darwin. Lamarck était
l’un des professeurs du Muséum au commencement du 19e siècle,
l’auteur, avec de Candolle, de la première flore française. Vous avez bien
souvent étudié des espèces créées par lui. Quant à Charles Darwin,
ça a été surtout un admirable observateur et un grand philosophe. Beaucoup
de gens en ont parlé qui ne l’on jamais lu, qui n’ont jamais
entr’ouvert un de ses livres. Il a d’ailleurs été
malheureux par certains cotés ! Il n’a trouvé comme traducteurs,
dans notre pays, que des gens qui ne le comprenaient pas et qui ne voulaient pas
le comprendre, qui ont voulu faire tourner sa philosophie au profit de leurs idées ;
cela n’a pas duré et ne pouvait durer. Mais les théologiens se sont émus,
ont lancé l’anathème contre un matérialisme dont il n’y a pas la moindre
trace chez Darwin. J’ai lu son œuvre,
au moins en partie, à Bailleul, pendant les vacances 1877. J’en ai
beaucoup causé, depuis, avec M. Dauverchain et avec le P.Ch. Lacouture.
J’ai, depuis aussi, expliqué à M. Eug. Cortyl pourquoi cet homme, qu’il
croyait être l’apôtre du matérialisme, avait été l’objet de funérailles
nationales en Angleterre et pourquoi il repose, au palais de Westminster, en
l’église où dorment les grands hommes de l’Angleterre, sous un tombeau qui
le révèle comme un chrétien. C’est qu’il l’était en effet ! La
tyrannie des idées reçues est telle chez nous que le pauvre Darwin, mort
depuis 25 ans, subit encore les effets de la mauvaise réputation que lui ont
faite ses traductions que personne ne connaît plus ».
Entre ces deux lettres, Charles Flahault a retrouvé sa vocation première.
Les
plantes et le milieu
« Herborisations en zigzag », ouvrage que Monsieur
J.-M.Emberger a, trop modestement, à mon avis, présenté comme une publication
posthume de son grand-père, est construit à partir des lettres que Flahault écrivait
à sa mère pendant ou au retour d’excursions botaniques jugées importantes
par leur durée ou par quelque élément pittoresque. Ce n’est pas seulement
un guide chronologique inestimable. Il est un témoin de relations très
exceptionnelles entre deux personnes parentes, unies par une profonde affection
et un intérêt commun pour les sciences naturelles et qui se refusent à parler
le même langage philosophique, par inquiétude de société, d’un coté, par
tendresse et par respect de l’autre.
Les quatre mois passés en Scandinavie d’août en novembre 1879 donnent
lieu à des lettres au moins bihebdomadaires, véritables chefs d’œuvre de
reportage, à la fois précises et spirituelles, où le voyageur décrit les
moindres détails du périple, les paysages, les gens, les fleurs naturellement,
les amis qu’il se fait, jusqu’à un quasi-flirt qui pourrait donner de la
consistance à des inquiétudes maternelles : Madame Flahault mère, son
attention ayant peut-être été attirée par une demande d’envoi de pièces
d’identité, exprime en effet la crainte qu’il ait l’intention de prendre
épouse dans l’un quelconque de ces pays étrangers dont il lui vante les
charmes. La réponse est donnée par des lettres datées d’Uppsala, les 9 et
13 octobre. C’est un vœu de célibat, à la manière de ce que pouvait être,
cinq siècles plus tôt, celui de l’enseignant chercheur. Pourtant, derrière
l’affirmation sincère d’un amour exclusif pour celle qui lui a donné le
jour, se dessinent les limites de l’intimité qui existera désormais entre
eux.
Je n’oserai pas dire que la vénération pour la Sainte Vierge et l’antidarwinisme
militant exprimés en 1874 sont de même farine. Flahault fut toujours un
catholique sincère. Les deux positions sont pourtant affirmées avec une force
que le contexte rend quelque peu surprenante. Le futur bachelier ès Sciences
devait très peu se soucier de faire acte d’allégeance à une tendance évolutionniste
ou à une autre et ce qu’il en dit montre seulement qu’il a bien
l’intention de ne pas mêler sa pensée scientifique -- pour peu qu’il en
ait déjà une – et ce qui est et reste une vie de famille à laquelle il
tient. C’est dans le même esprit que, plus de
trente ans plus tard il prendra, à toutes fins utiles car les temps ont
changé, la défense des
transformistes. Il n’est pas, lui, un évolutionniste, non qu’il pense que
les organismes ont toujours été ce qu’ils sont mais il ne se sent pas
vraiment concerné.
Au cours de l’été 1877, il est à Bailleul, en vacances dans sa
famille. Il y introduit en cachette un ouvrage défendu. Au fait, Darwin est-il
vraiment défendu ? Le confesseur, consulté, se renseigne. Non. Il y a
bien un Darwin dont un ouvrage est à l’index, on ne sait d’ailleurs pas
bien pourquoi mais c’est un Erasmus, pas un Charles, Dieu soit loué !
Quant à porter le débat vers celle qui n’est encore que « chère maman »,
lui en communiquer l’objet, il n’en est pas question. Qu’il soit vrai ou
non qu’il y a été dit que l’homme descend du singe importe peu. Tout se
passe bien comme s’il s’agissait d’un ouvrage pornographique et il sera
bien entendu que la non-condamnation résulte directement de ce laxisme que
l’on reproche si souvent à la papauté.
On lit donc Darwin en cachette mais on le lit. On y lit, par exemple :
« Pouvons-nous être satisfaits d’admettre que chaque Orchidée a été
créée, exactement telle que nous la voyons aujourd’hui, d’après un
certain « type idéal » et que le tout puissant Créateur, ayant
tracé un plan unique pour toute la famille, n’a pas voulu s’écarter de ce
plan ? … N’est-il pas plus simple et plus intelligible d’admettre que
toutes les Orchidées doivent leurs caractères communs à leur descendance de
quelque plante monocotylédone… ? » Dieu, en effet, doit avoir
autre chose à faire que vérifier que le nombre d’étamines de chaque espèce
est bien celui que fait prévoir sa place dans la classification. On peut, sans
être un sulfureux matérialiste, opposer « l’observateur
pleinement convaincu que des lois coordonnées régissent la structure de chaque
être … au naturaliste qui voit dans
les plus petits détails de structure le résultat de l’action directe du Créateur ».
L’évolution, les squelettes du Muséum, l’anatomie comparée …On
ne peut plus se contenter d’une création qui aurait eu lieu en 4004 avant
J.C. et qui n’aurait demandé qu’une semaine, repos dominical compris. Les
théologiens eux-mêmes sont d’accord pour admettre que les sept journées de
la Genèse sont, en réalité, des périodes plus longues. Darwin va plus loin.
Il refuse d’admettre que chaque détail de structure soit
voulu par le Créateur. Il refuse
l’argument d’intention. Les naturalistes ont fait l’utile inventaire
des détails ; nous devons maintenant travailler à l’observation qui
nous rapprochera « des lois régissant les structures ». Charles
Darwin est un admirable observateur. Charles Flahault était un naturaliste. Il
va devenir un observateur. Pour ce qui est de la sélection naturelle et autres
théories, on verra plus tard.
Les deux premières publications
de Flahault datent de 1877 et indiquent clairement ce que ses maîtres attendent
de lui. Il doit s’asseoir dans un laboratoire, devant un microscope de préférence
et décrire ce qu’il voit. Tiges et tigelles, racines et radicules seront
finement coupées en tranches et les coupes dessinées pour nourrir cette
anatomie au nom de laquelle les élèves de Van Tieghem – Vantige : les
étudiants doivent franciser les noms étrangers pour avoir une bonne note --
coloniseront les chaires de Botanique des universités françaises jusqu’à la
première guerre. Il faut décrire. Pour la thèse, en 1878, il pourra aller
jusqu’à décrire non plus seulement des racines mais des allongements de
racines. Il lui faudra le faire sur 350 espèces, ce qui lui permettra de découvrir
que l’allongement n’est pas le même selon que l ‘espèce est à un
ou à deux cotylédons. Il n’y a pas à se demander pourquoi pour le
moment, encore moins à chercher à faire entrer dans sa vie familiale, c’est-à-dire
dans sa correspondance avec sa mère, des préoccupations scientifiques qui ne
la concernent pas. M. Emberger me confirme qu’il le ne le fera pas…avec,
toutefois, une exception, unique à quelques détails près, purement matériels.
Il compte, en effet, écrit-il le 15 mai 1878, se consacrer à « l’étude
de l’influence qu’exerce le milieu sur la structure anatomique des organes
des plantes ». C’est une conversion. Sans doute précède-t-elle immédiatement
la première mission en Scandinavie.
Que s’est-il donc passé ? Son camarade
à l’Ecole Normale, Gaston Bonnier, son puîné d’un an par l’âge
comme par le niveau d’études, est licencié en 1877. Tous deux décrochent
une première mission pour la Scandinavie, en 1878, une autre en 1879.
Ils en ramèneront les quatrième et cinquième publications de Flahault,
toutes deux signées, toutefois, de Bonnier comme premier auteur. Tout paraît
donc bien indiquer que Bonnier est le meneur de jeu, que c’est lui qui a donné
à l’aîné le désir de s’évader du laboratoire. Il l’a convaincu que
son destin scientifique était non plus de décrire les structures des végétaux
mais d’étudier leurs réactions au milieu.
Les deux publications sont
datées de 1878. Le titre de la première – dont la seconde est, à peu près,
une présentation -- ressemble beaucoup au programme annoncé : « Observations
sur les modifications des végétaux suivant les conditions physiques du milieu ».
On y étudie d’abord les effets, entre autres facteurs, de l’altitude et de
la latitude sur la répartition des flores. C’est en somme, de la géographie
botanique. Près de la moitié du mémoire, toutefois, est consacrée aux
« Variations dans une même espèce » : avec la latitude, par
exemple, augmentent l’éclat des pigments colorés, la quantité de
chlorophylle, la dimension des feuilles et même, dans certains cas, la
production de nectar. Chemin faisant, un ouvrage d’un M. Schübeler vient à
la connaissance des voyageurs. Cette personne a eu l’idée de
semer des graines d’une même plante –
Rhodanthe maculata Thomps -- à 60 et 70 degrés de latitude. C’est un peu
étrange. Semer des graines, c’est ce que fait un jardinier, élève ou maître,
non un docteur ès Sciences Naturelles. Le résultat n’en est pas moins
remarquable. On a obtenu, au Nord, un éclat des fleurs beaucoup plus vif, ceci
dès la première année – et, cette fois, les italiques sont d’origine !
« On ne saurait donc voir, dans cette coloration, un fait d’adaptation ».
Qu’entendent donc ces Messieurs par là ? On aurait pu
s’attendre à ce qu’en semant pendant plusieurs années de suite le
Rhodanthe maculata Thomps, dans chacune des deux localités, en utilisant
chaque année les graines produites sur place, on ait obtenu une transformation
progressive, une acclimatation, si la
couleur brillante qui caractérise les fleurs des espèces nordiques est due au
climat froid. Cette acclimatation aurait alors conduit à l’adaptation,
c’est-à-dire un état adapté, une
adéquation entre la plante et le milieu, non un processus. Il n’en est rien.
Qu’en conclure sinon que cette brusque réaction au milieu nordique est une propriété de l’espèce ? L’espèce elle-même ne
varie pas, il n’y a pas adaptation, l’adéquation a toujours existé et se
maintient. Pour généraliser, l’adaptation
n’existe pas. La sélection naturelle existe, bien sûr mais il ne
faudrait pas la voir en marche dans les moindres détails observés et, surtout,
la laisser mettre en cause la réalité et la stabilité de l’espèce.
L’espèce, outil de base du naturaliste, ne saurait manquer à
l’observateur.
Lorsque le grand Linné entreprit son gigantesque travail, son objectif
était de faire l’inventaire de la création. Les organismes qu’il étudiait
ont été créés par Dieu, manufacturés, pourrions-nous dire. Ce sont des modèles d’objets existant en des nombres d’exemplaires non précisés.
On devait donc pouvoir en dresser un catalogue, comme pour des produits
industriels ou encore pour des livres. Il donna à chaque espèce un nom, comme
Dieu, nous dit la Genèse, avait suggéré à l’homme de le faire. Pour
faciliter les choses -- pour faciliter la classification, en particulier -- ce
nom fût un binôme, permettant de
classer per genus proximum et differentiam
specificam, par le genre le plus voisin et la différence entre espèces.
Parvenant au terme de ses possibilités d’études, le grand Linné trouva,
paraît-il, que non, vraiment, Dieu n’avait pas pu faire, manufacturer,
fabriquer ce que lui, Linné, n’était même pas parvenu complètement à décrire.
Dieu, à coup sûr, avait fait les genres mais il avait dû laisser la formation
des espèces à cette évolution dont on allait commencer à parler.
Flahault ne le suit pas dans cette voie. Les lacunes laissées par Linné
ont été à peu près toutes comblées
par les excellents naturalistes qui se sont attelés à cette tâche. Il suffit
de compléter le binôme linnéen par
l’indication du nom de celui qui a réalisé la première description, la
diagnose, d’une forme jusque là innommée -- ou mal nommée. On obtient ainsi
un trinôme permettant
l’identification sans la moindre ambiguïté. Cela entraîne que, pour la
plupart d’entre eux, les binômes sont complétés, d’après Linné, par la
lettre L mais ce n’est que justice. Rhodantha
maculata Thomps était peut-être une espèce
que Linné n’avait jamais rencontrée ou qu’il avait mal nommée pour
quelque raison, qu’il avait mal classée, confondue avec une autre … Un M.
Thompson, sans aucun doute bien connu des biologistes comme étant l’un des
nombreux et brillants successeurs de Linné, a mis de l’ordre dans le désordre
linnéen, a fait de ce qu’il observait une description, une diagnose, qu’il
a publiée. Dès lors, l’espèce a existé, dans toute sa réalité,
incontestable, une et indivisible. M. Thompson est l’auteur
de l’espèce désignée par le trinôme. Si un autre botaniste, à partir de
la même plantes, la décrit et la nomme autrement, il reviendra à un troisième
de départager les deux premiers etc..
Flahault dispose donc d’une excellente définition de l’espèce et il
s’y tiendra toute sa vie. L’espèce,
c’est ce qu’un spécialiste, appelé l’auteur, qui a réussi à vous
convaincre de sa compétence, estime être une espèce. Il ne s’agit
nullement d’une boutade. Le spécialiste, on l’a dit, c’est souvent le
grand Linné lui-même. Ainsi Flahault peut-il écrire, -- en 1934 ! --
à propos des cèdres : « Avec la
plupart des botanistes contemporains, nous admettons trois espèces, assez
voisines les unes des autres. Cela nous suffit. Qu’ils aient une origine
ancestrale commune remontant aux périodes géologiques révolues, c’est un
problème dont la solution nous échappe. Demeurons dans le domaine des réalités
positives ; il est assez vaste à notre gré ».
Flahault ne s’intéressera jamais à la variabilité interne à l’espèce
qu’il étudie. Mendel lui fera hausser les épaules. Peu avant de terminer son
enseignement, vers 1927, il donnera
comme sujet de DES à l’un de ses étudiants – qui fût mon professeur et de
qui je tiens une copie du mémoire – la répartition des sexes chez un certain
nombre de végétaux dioïques de la région. Les comptages confirment qu’il
n’y a jamais égalité. Ainsi pour la mercuriale : 103 mâles pour 96
femelles seulement ont été trouvés au cours de ce travail. Des résultats au
moins aussi différents du « un
pour un » prévu seront obtenus pour les genévriers, l’asperge … Dès
lors, comment prendre au sérieux des disjonctions plus complexes, comme le
« trois quarts - un quart » des expériences sur les pois ?
Surtout, qu’a donc la systématique à voir avec des recherches sur
l’hybridation ? Quant au mutationisme et à la théorie chromosomique de
l’hérédité, j’ai de bonnes raisons de penser que Flahault partageait, à
leur sujet, l’opinion de ses collègues sorbonnards : il ne s’agissait
pas de science, en tous cas pas de biologie. Il dût, d’ailleurs, avoir
P.P.Grassé comme auditeur, sinon comme élève.
On aurait pu penser que la naissance d’un enseignement de la génétique
en France devait mettre fin à la conception fixiste de l’espèce. Cette
conception reste, en fait, celle qui préside, en Europe, à la l’amélioration
des arbres forestiers et à l’organisation de la production des plants de pépinière
de « formes améliorées, ou variétés » de chaque « espèce ».
Comment pourrait-il en être autrement ? Nos forestiers jouissent, chez
leurs confrères des pays voisins, d’une très flatteuse réputation. Or,
c’est de Flahault que Guinier, à l’Ecole de Nancy, tenait ses dernières idées
sur la botanique . Lorsqu’en 1951 Pourtet, son élève, tentait, à l’Hort
de Dieu, de m’apprendre à distinguer un Nordmann d’un céphalonica, il me disait, en passant, que les deux « espèces »
s’hybridaient spontanément. Il me montrait, d’ailleurs, de jeunes repousses
qu’il se refusait à identifier et qui, d’après M. Rol, étaient des
« sapins méditerranéens ». Je lui faisais remarquer que s’il
s’était agi de melons, non moins interféconds, on aurait parlé de « variétés ».
« Pour nous, me répondait-il, c’est plus commode comme ça ».
C’était, en effet, que, dans le cas des arbres forestiers, il est plus commode
pour l’utilisateur de les désigner par un binôme linnéen. Pour
qui fait des recherches sur la « diversité génétique », c’est très
malcommode, car, pour lui, la seule
espèce possible est, ou devrait être, celle qui est isolée des autres – ou,
au moins, commence à l’être.
Montpellier,
1881
Après six ou sept cents ans d’enseignement de La
Science dans l’une des trois plus anciennes et prestigieuses Facultés de
Médecine européennes, l’Université vient de créer une Faculté des
Sciences. Charles Flahault y est nommé maître de conférences, puis élu
professeur. Il n’a pas de laboratoire. Ne voyant pas comment il pourrait se
contenter de faire des cours, il fait travailler les étudiants dans un grenier,
dans un couloir quand il y fait trop chaud. C’est dans ces conditions qu’il
fait son apprentissage de naturaliste méditerranéen et -- la paillasse
restant, pour un scientifique, l’inévitable Poste de Commandement – qu’il
reprendra ses recherches sur l’appareil reproducteur des cryptogames,
l’algologie étant particulièrement indiquée pour assurer la liaison avec un
milieu marin qui domine la région de ses influences climatiques.
Serait-ce que la reproduction des algues finit par l’obliger à penser
que la fonction de reproduction est toujours fondatrice ? Mon père, pour
occuper une année vacante avant son Service Militaire et se rapprocher des Sciences, aborde les seules qui ne sont pas hostiles à qui a dû
passer des examens oraux en latin : il suit le cours que Flahault professe,
en 1901, sur la Reproduction des Végétaux. Quatre ans plus tard, alors
qu’ayant terminé sa licence il s’oriente vers la physique, il écrira à ma
mère, en quête de bibliographie, que « c’est là toute la botanique ».
Le Maître, bien sûr, a rompu avec le célibat en 1898, à l’âge de quarante
six ans. En bon citoyen, en bon catholique, il a fondé une famille. Pour la
maturation de sa pensée, quel a été le rôle du long célibat préalable
à cet aboutissement paisible ? Notons que 1901, c’est un an avant les premières
plantations de l’Hort de Dieu …
En janvier 1889, il est chargé d’organiser un Institut de Botanique.
Ce n’est pas une mince affaire. Il est loin d’être le seul botaniste de
l’université, encore plus loin d’en être le premier, presque aussi loin
d’en être le plus important, le plus prestigieux. Les pharmaciens ont hérité
des prérogatives botaniques des médecins mais ceux-ci n’entendent pas se
laisser déposséder des infrastructures et tout d’abord du célèbre Jardin
des Plantes, fondé trois siècles plus tôt par Richer de Belleval et qu’un médecin
continuera à diriger, avec qui on est condamné à s’entendre. Les géographes
eux-mêmes se sentent concernés. Toutefois, le prestigieux herbier de quelques
centaines de milliers d’échantillons, dont plusieurs milliers d’importance
nomenclaturale, ne saurait évidemment échapper au botaniste officiel. Flahault,
donc et nul autre, construira le charmant petit ensemble de pierres du pays dont
il dessine un avant-projet pour sa mère. Il le dirigera pendant trente huit
ans. Il y aura enfin un petit laboratoire pour lui, un grand laboratoire pour
les étudiants, de quoi permettre de travailler à deux ou trois chercheurs,
enseignants ou non, un amphithéâtre pour y faire ses cours et pouvoir y
accueillir des conférenciers extérieurs. On ne peut y entrer qu’en
traversant le Jardin des Plantes : il est adossé à un mur aveugle, intérieurement
bordé de cyprès, qui le sépare de la rue voisine.
En 1889, Flahault trouve qu’il est assez confortable et que sa gestion
administrative et technique est suffisamment prenante pour qu’il renonce aux séjours
prolongés hors de la région. Celle-ci sera donc étudiée à fond dans
l’optique définie dix ans plus tôt, celle des rapports entre la plante et le
milieu, le climat surtout. Il cherche à généraliser ses conclusions. « Je
m’ingéniai, est-il encore heureux et fier d’écrire vingt cinq ans plus
tard, à faire comprendre le monde végétal au contact duquel nous vivons, à
en saisir les traits généraux et à les exprimer clairement ».
Saisir les traits généraux – lesquels, dit Montesquieu, entraînent les
accidents particuliers -- c’est réformer
la Géographie Botanique :
« … nous y cherchions en vain les idées générales
et les éléments d’une synthèse ».
Il sera parmi les premiers à parler de Phytogéographie, puis de
Phytosociologie. Pour « exprimer clairement » les résultats, il
faudra inventer des techniques, des méthodes. Sa Géographie, tout
naturellement, deviendra une Cartographie et, pour devenir Cartographe,
il faut savoir choisir une échelle.
Sur un territoire grand comme le dixième de la France, à l’échelle
du 1/200.000, il expérimente sa méthode et en propose
la généralisation à tout le territoire. Il serait ainsi possible, d'opérer
une réduction au 1/500.000, puis au 1/1.000.000, pour obtenir la publication
d’une carte botanique et sylvicole, « comme on l’a fait pour la carte
géologique de France ». Est-ce la synthèse
rêvée ? Il a « la ferme confiance que l’agriculture française
tirerait parti de cette publication ». Le monde scientifique, en tous cas,
est enthousiaste. En 1897, le projet est présenté au Ministre de l’Agriculture,
cautionné par des autorités aussi incontestables que celle de Pierre Viala, le
sauveur du vignoble français. Tout le monde fait des promesses – sans suite
…
Il est « déçu ». Il a ignoré qu’aucun Ingénieur des
Mines, aucun chercheur de quelque matière précieuse enfouie en profondeur dans
le sous-sol ne viendrait consulter sa carte. Il ne sait pas, faute d’avoir
approché davantage ces agriculteurs qui lui déplaisent parce qu’ils ne
savent encore que mal, sinon pas du tout, parler français, que ce qu’elle
permet de prévoir est, le plus souvent, connu d’eux depuis longtemps ou le
sera, au besoin, avant la fin des travaux qu’il propose. Il fait état de la réussite
de ses projets à l’étranger, pour justifier ses efforts et montrer une fois
de plus l’incapacité de la France à utiliser les découvertes de ses savants
après avoir négligé de les encourager. Qui le contredirait ?
Il apprendra pourtant, comme le feront ses successeurs divers, qu’une
carte botanique est difficile à vendre.
Georges
Fabre
Un forestier prophète. Par bonheur, il lui reste – pour le moins
-- ce qui fait vraiment le botaniste, dans l’esprit de chacun : il
herborise. Dès 1887, l’organisation d’une excursion botanique pour les étudiants
le met en contact avec un forestier, Georges Fabre, dont il admire le travail de
reboisement à l’Aigoual. Cinq ans plus tard, il le connaît encore assez peu
pour parler de lui à sa mère comme d’un « très jeune et très aimable
inspecteur forestier » -- alors que Fabre est de huit ans son aîné.
Cependant, une nouvelle excursion est l’occasion d’une première visite au
site prestigieux de l’Hort de Dieu, marqué, dans la tradition, par le passage
des botanistes de la Renaissance. Elle marque sans doute le début de relations
suivies entre les deux hommes.
Lorsqu’il fit, dans l’admirable notice nécrologique publiée en
1912-13 dans le volume 40 du Bulletin d’Etudes des Sciences Naturelles de Nîmes
et du Gard, la biographie de Fabre, nul mieux que Flahault ne pouvait faire cet
éloge du forestier-savant – savant par obligation. Il avait compris, en
effet, que Fabre, forestier mais, comme lui, chercheur, étudiait, comme lui
depuis la naissance de sa collaboration avec Bonnier, les rapports de la plante
et du milieu, mais il le faisait à une échelle beaucoup plus grande, à peu près
en vraie grandeur, en somme ... Une carte au millionième, valable pour
l’ensemble de la France, lui aurait été inutile. Comme lui encore, Fabre
enseignait mais il enseignait à des gardes n’ayant, au mieux, que leur
certificat d’études et à des ouvriers analphabètes. Ces auditeurs n’étaient
pas « fascinés », comme l’étaient mes parents lorsqu’ils
suivaient les cours de Flahault. Comme lui toujours, il observait avec une
attention passionnée mais ses méthodes étaient frustes. Leur précision était
limitée mais suffisait à des besoins immédiats.
Il ne demandait à la présentation que d’être assez simple pour être
utilisable. Dès sa prise de fonction, en 1872, il avait commencé à étudier
le comportement de la douzaine d’essences forestières en usage en fonction
des trois éléments qui lui paraissaient importants dans une région de basse
ou moyenne montagne, altitude, exposition et sol. Le
tableau qu’il en établit moins de quatre ans plus tard fait toujours partie
des documents remis aux services locaux. Mieux, son esprit suffit encore à
l’utilisateur sur le terrain -- qui sourit lorsqu’on lui recommande
maintenant de tenir compte du « cortège floristique ». Il serait
parfaitement moderne s’il avait été complété par les essences exotiques
dont on a su, depuis, qu’elles n’avaient pas été éliminées dans les
arboretums, les arboretums qu’il avait établis à des altitudes, des
expositions et sur des substrats géologiques différents
Flahault avait, autant que Fabre, travaillé sur le terrain. Son ambition
étant de généraliser ses résultats, il avait tout naturellement augmenté
progressivement l’étendue qu’il pensait représenter, s’éloignant
d’autant du terrain. Commençant au 1/80 000, son
objectif était, toutefois, limité.
Il ne s’agissait pour lui que de donner une représentation botanique
de la France, qui se laisse si facilement encadrer dans un panneau de 1m de
haut. Or, trop petite pour une application locale, l’échelle du millionième était
beaucoup trop grande pour faire apparaître la diversité mondiale des
flores. Là où l’un disséquait longuement la végétation de quelques départements,
l’autre courait le monde pour reculer les limites de sa connaissance des
possibilités de l’arbre. Il en avait rapidement conclu, comme le dit Flahault
dans sa notice « … que l’Europe
occidentale est particulièrement pauvre en essences ligneuses et [il] prévoyait
qu’un jour il pourrait être utile ou nécessaire de recourir aux essences
exotiques ». Dès 1882, il écrivait : « Il semble que le rôle
de l’Etat soit de mettre à profit des terrains domaniaux
pour essayer en divers points et dans des climats variés l’introduction
d’essences étrangères au pays ». Le
rôle de l’Etat, non plus celui d’horticulteurs privés, de pépiniéristes
souvent habiles et même dévoués mais ne sachant, sous peine de disparition,
oublier leurs intérêts.
Un siècle plus tard, nous avons appris ce que sont « les événements
antérieurs à la venue de l’homme sur la terre » qui expliquent
pourquoi il en est ainsi. Nous savons que les glaciations quaternaires ont détruit
les végétaux en fuite devant le froid lorsqu’ils ont buté contre une trop
proche Méditerranée, alors que tous les refuges nécessaires existaient dans
les vastes espaces et les reliefs gigantesques du Nouveau
Continent et de l’Asie. Nous avons du mal à comprendre que sur les lieux mêmes
des travaux de Fabre, des textes législatifs inexplicables, traduisant ce que
l’on espère n’être que des superstitions, prétendent empêcher les
introductions d’essences nouvelles dans le domaine de l’Etat ou contrôlé
par lui, quitte à être plongés dans le ridicule par les réalités,
biologiques ou professionnelles.
Qui Fabre était-il, au juste ? Sa carrière débute en 1968. Il est
nommé garde général et affecté à Mende. Il fera ses premiers achats pour
les Domaines en 1874. Officier des Eaux et Forêts, il est, ou est destiné à
être un « grand commis de l’Etat », comme le sont les Inspecteurs
des Finances, de ce Ministère dont il sera encore fonctionnaire jusqu’au
passage au Ministère de l’Agriculture, un tournant pour la Forêt. Guère
plus de deux siècles avant, il n’y avait pas de Forêt mais des forêts,
fonds de commerce que l’on achetait et exploitait comme on l’aurait fait
pour une ferme d’élevage : les frais de gardiennage formaient le premier
des postes budgétaires. Faire « une Forêt » supposait donc
d’abord une réglementation sévère, comme une Police ou une Armée et les
fonctionnaires devaient d’abord y obéir à des Officiers, porter des armes et
savoir s’en servir. De ces militaires à peine imités, il allait falloir
faire des biologistes.
Fabre était biologiste. Il était aussi polytechnicien. En 1864, un
bottier de l’X pouvait choisir l’Ecole Forestière comme école
d’application, même s’il était protestant et géologue amateur ; il
n’y serait pas brimé, comme les premiers agros qui y furent admis sans
concours. Encore eut-il été de bon ton pour lui de ne pas s’y faire
remarquer. Fabre en sortit premier, ce qui ne dût pas lui être très
difficile. On voulut bien le lui pardonner. On lui pardonna moins facilement une
possible désinvolture, de parler, par exemple, du mélèze comme ayant une
fonction diplomatique : c’est probablement en commun avec Flahault,
d’ailleurs, qu’il se gaussait des Inspecteurs Généraux, peu enclins à
inspecter avec un soin exagéré l’intérieur des reboisements et qui se
satisfaisaient aisément de trouver sur le bord des routes des arbres dont ils
savaient mieux que personne qu’ils poussent vite et servent facilement de
« vitrine ». La plaisanterie faisait
partie de l’enseignement de Guinier, qui était bien placé pour savoir que
Fabre se méfiait de la « mode » du mélèze, peu adapté aux vents
violents de l’Aigoual.
On pardonna encore moins à Fabre de « voir grand », ce
qu’il faisait parce qu’il savait qu’un programme trop réduit ne pourrait
fixer une population en cours de départ vers les plus misérables des banlieues
des villes. Il fût accusé, dès les années 1880, de « faire des expériences
au niveau du canton ». En fait, il n’avait pas le choix – mais il
reste qu’à « expérimenter », à agir avec trop d’audace, le
forestier risque autant que le militaire.
Il ne semble pas possible d’apprendre dans quelles conditions il fût
« relevé de son poste de combat ». Les archives seraient muettes.
Dans son lignage, on dit qu’à sa mort, alors qu’il était resté profondément
blessé par les mesures prises à son encontre, il aurait fait promettre à ses
proches de se tenir à l’écart de tout contact officiel le concernant. Cette
sorte de bouderie posthume ne paraît pas s’harmoniser avec ce que dit
Flahault du caractère de son ami et avec les paroles qu’il cite de lui. En
tout état de cause, la promesse, si l’on admet que promesse il y a eu, fut
tenue. On doit en être ému. Une remarque s’impose pourtant, importante car
touchant à la vie de la collectivité, qui est qu’un peu de lumière
n’aurait pas été inutile. Fabre n’a pu être seulement victime de mesquineries. Un débat contradictoire aurait
peut-être été l’occasion de montrer les difficultés d’une mutation nécessaire
et le besoin croissant de souplesse dans les règlements forestiers. Ceux-ci
restent imprégnés d’une rigueur qui peut prendre le pas sur une stricte
conscience du bien public, voire de la justice, explicable autrefois mais qui ne
peut être maintenue en démocratie moderne, quand une catastrophe naturelle,
incendie ou tempête, oblige l’Etat à des efforts de solidarité autrefois
inconcevables. Ajoutons que la discussion aurait rendues impossibles les
attaques incohérentes par lesquelles les « écologistes », dans une
publication luxueuse autant que scientifiquement vide, ont récemment mis en
question, pêle-mêle, la valeur de Fabre et l’aptitude de son administration
à gérer la forêt et son personnel.
En 1892, les premiers reboisements de Fabre avaient déjà une quinzaine
d’années. Par la suite, Flahault ne put que l’envier d’avoir de brillants
résultats de ses plantations, qui étaient des expériences
de géographie botanique, là où lui-même n’avait guère tiré de ses observations que des compliments gratuits. Fabre l’amena, en
somme, à reconnaître que sa vocation première de jardinier était bien la
seule qui convenait à son tempérament quelque peu « sacerdotal »
de célibataire prolongé : l’action à laquelle devaient le conduire ses
observations, c’était l’étude de la
reproduction des organismes observés. En lui montrant ce qu’est, en vraie
grandeur, la reproduction dans la nature de la forêt,
il en fit un apôtre de la phytogéographie expérimentale.
La meilleure semence. Un arbre forestier, comme bien d’autres
organismes ne disposant pas de moyens élaborés de protection de leur progéniture,
produit un nombre énorme de spores. Au cours de sa vie, il peut laisser dans le
sol de la forêt de nombreux millions de graines. Il ne lui en faut qu’une
pour assurer sa descendance. Comment sera-t-elle choisie ? Au hasard ?
Certainement pas. Dès sa formation sur l’arbre, dès sa conception et
jusqu’à sa disparition définitive, par décrépitude toute naturelle, par
accident ou par la volonté de l’homme, la graine sera l’objet, comme
l’individu arbre qui en sera, éventuellement, issu, d’une sévère sélection
naturelle, la sélection du plus apte à
se reproduire, à transmettre ses gènes. Fabre montra à son « élève »
les fréquents bouquets de pousses de hêtres, restes de semis spontanés
persistant dans les clairières. L’une d’entre elles peut, si les
circonstances continuent à lui être favorables, donner -- statistiquement,
bien sûr -- l’arbre unique qui
remplacera l’individu enlevé par l’exploitant ou par le jeu normal du
vieillissement. Les tapis de jeunes plants d’épicéas paraissant avoir tous
le même âge et dont s’étonne le promeneur curieux sont aussi rares, sans
doute, que la curiosité chez le promeneur mais ils racontent la même histoire.
Finalement, c’est le reboiseur qui doit – grâce à son expérience d’une
situation bien difficile à analyser – faire efforts pour que l’arbre adulte
soit héréditairement le meilleur
possible des jeunes plants installés, ce qui suppose un nombre suffisant de
ces jeunes plants et, par la suite, un « dépressage » judicieux et
des martelages appropriés. Nous dirions aujourd’hui que la prolificité de
l’arbre lui permet de supporter le « fardeau génétique » de la
diversité : pour qu’il y ait un « bon », il faut que
disparaissent, en masse, des mauvais ou seulement moins bons ou seulement différents.
En résumé, la meilleure des semences est celle qui tombe de l’arbre
à remplacer, comme cela paraissait autrefois bien établi, du reste. Si cela ne
suffit pas à maintenir l’essence à un bon niveau d’adéquation génétique
au reste de la forêt, il faut changer d’essence, remplacer -- pour prendre un
exemple -- l’épicéa, si la pourriture du tronc le menace vraiment, par
quelque autre conifère, pas obligatoirement le Douglas. Si cela ne nous plaît
pas, nous devons renoncer à la forêt et nous occuper d’agriculture – ager
et non sylva. On le fait pour le peuplier – mais ceci, semble-t-il, ne
nous concerne pas pour le moment, heureusement, du reste. Le clonage a fait
merveille pour faire de la culture de la pomme de terre une organisation de la
lutte contre les maladies à virus. Son utilisation en sylviculture véritable
ne peut que réserver des surprises -- peut-être bonnes, après tout.
La sélection naturelle de la meilleure des graines qui tombent d’un
arbre suppose plusieurs conditions. La première est que la graine de l’avenir
ne tombe pas trop loin de l’arbre qui l’a mûrie. C’est généralement ce
qui se passe pour les chênes et leurs glands. Les frênes et les érables, avec
leurs graines outillées pour le vol héliporté à longue distance, sont plutôt
faits pour rechercher le moyen de laisser le plus de gènes possible dans des régions
plus ou moins lointaines. Ce n’est plus le milieu qui choisit l’individu
mais l’inverse. Les graines de nos conifères limitent leurs projets de
voyage, en restant souvent réunies en cônes presque jusqu’au moment d’une
possible germination.. Elles tendent à former des domaines dans lesquels elles
sont les meilleures possibles, sans aucune prétention à l’être en
d’autres lieux.
La seconde est que ces graines soient nombreuses. La quantité de graines
produites étant fonction directe du volume de l’arbre, leur qualité dépend,
toutes choses égales, des objectifs du forestier et, éventuellement, de
l’efficacité avec laquelle la forêt sera conduite en vue du développement
maximum des individus.
La troisième condition est que ces graines soient génétiquement
diverses, pour que la sélection naturelle soit la plus efficace possible. La sélection,
en effet, s’exerce à des milliers de stades successifs, à chacun des quels
elle doit laisser subsister les plus aptes des « compétiteurs » en
présence, graines, plantules, jeunes resemis, arbres adultes puis
vieillissants, innombrables au début, puis se réduisant de plus en plus en
nombres. Pour qu’une sélection soit efficace, il faut que la diversité des
objets sur lesquels elle s’exerce soit suffisante. La diversité génétique
est le résultat d’un régime de la
reproduction sexuée soumis à la fécondation croisée. Les généticiens
des populations ne savent pas encore donner, de la reproduction sexuée, une
raison d’être absolument convaincante. Ils savent fort bien expliquer, par
contre, pourquoi la fécondation croisée – l’hybridation permanente et
presque parfaitement désordonnée entre tous les individus de la population, à
la manière de l’homme, somme toute – assure « l’hétérozygotie
maximum », la plus grande diversité possible des patrimoines héréditaires
des individus soumis à la sélection. De ce régime d’ouverture qu’est la fécondation
croisée -- qu’elle soit, dans leurs cas, assurée par les insectes ou, plus
souvent, par le vent -- nos arbres forestiers sont les plus convaincants des
exemples. La graine peut être la meilleure ou la pire pour tout ce qui concerne
la production à l’hectare, la qualité du bois, la résistance à tout ce à
quoi il est possible de résister, froid et chaud, humidité et sécheresse,
maladies et prédateurs divers et jusqu’à l’aptitude de la forêt à être
traitée en taillis, en futaie, régulière ou jardinée ou de toute autre manière.
Pour qu’elle puisse être la meilleure pour tout cela, il faut qu’elle
puisse aussi être la pire : il faut qu’il y ait tant de graines
produites que toutes les combinaisons possibles de qualités et de défauts
puissent être réalisées.
Fabre savait cela de façon intuitive. Sans doute était-il sincère
lorsqu’il se plaignait de la mauvaise qualité des graines de pins sylvestres
que lui fournissait son administration. Sans doute était-ce pourtant avec une
certaine satisfaction qu’il accueillait l’obligation de choisir ses
semenciers parmi les plus beaux spécimens de la région, où l’espèce – Pinus
sylvestris L. -- est la seule
représentante indigène du genre, incontestable et bien « chez elle ».
Sans doute aussi aurait-il trouvé contre-indiqué d’en fournir les produits
pour une utilisation dans d’autres montagnes, ce que personne, à vrai dire et
pour des considérations autres que génétiques, ne dût jamais lui demander.
Quant à Flahault, il acceptait sans doute sans difficulté ce que Fabre
lui disait de la supériorité des semences locales, qui lui paraissait justifié
par l’expérience. Scientifiquement, il n’en était pas convaincu au point
de manquer l’occasion de critiquer une administration dont il estimait que le
forestier avait décidément à se plaindre.
Espèce et écotypes. C’est encore de manière intuitive que Fabre
savait que l’isolement, montagnard ou autre, qui interrompt le flux
pollinique, favorise, par le mécanisme que j’ai décrit, la formation d’écotypes.
Le mot n’était malheureusement pas disponible à son époque. Pourtant, Fabre
avait reconnu l’existence de « races … d’une même espèce …adaptées
à des climats différents ». A distances modérées, hexagonales, par
exemple, on parle de sapin des Vosges et de sapin de l’Aude. Les habitués
savent les reconnaître aussi bien l’un de l’autre que Flahault le faisait
de ses cèdres du Liban ou de l’Atlas. Ils n’en éprouvent pas, pour autant,
le besoin de leur donner des noms d’espèces différents. Il s’agit toujours
d’Abies alba Miller, à moins que
des considérations botaniques ou historiques fassent, à Miller, préférer de
Candolle et le trinôme devient alors Abies
pectinata D.C. ou encore que l’on désire conforter une image de marque de
spécialiste vraiment compétent du genre Abies
en plaçant l’une des désignations après l’autre, entre parenthèses, précédée
du signe =.
Il en est autrement à distances européennes, lorsque les explorateurs
de telle partie montagneuse du Caucase identifient un sapin pectiné qui ne leur
paraît pas être aussi normalement pectiné qu’ils le pensent et en
soumettent à leur retour des échantillons aux spécialistes. Dès lors, le
sapin va être décrit et nommé par une bonne vingtaine de botanistes qui vont
tenter de lui donner le nom – d’espèce – leur paraissant le plus indiqué.
Il appartiendra successivement ainsi aux genres Pinus
puis Picea, pour devenir définitivement,
vers le milieu du 19e siècle un Abies
et prendre une douzaine de désignations spécifiques différentes avant qu’un
M. Spach, spécialiste ayant réussi à convaincre les autres de sa compétence
à le distinguer – par l’étalement et la densité des aiguilles, l’acuité
du mucron et un certain nombre d’autres caractères morphologiques -- du sapin
décrit par M.M. Miller et de Candolle, se donne comme son auteur après lui avoir trouvé un dédicataire, un certain M. Nordmann, qu’il a quelque raison
d’honorer. Cet Abies nordmanniana
Spach. est, comme on peut le penser d’un sapin des régions montagneuses du
Caucase, résistant au froid et peut donc rendre des services dans d’autres régions
froides de l’Europe. Si M. Spach s’était contenté d’en recommander
l’utilisation à bon escient, il aurait simplement rendu service à la
sylviculture. Il a voulu lui donner une identité spécifique, en le supposant
isolé, tant génétiquement que géographiquement. Or, l’isolement géographique
est rompu depuis le retour du premier explorateur porteur d’un échantillon
convenable – retour qui doit dater de deux ou trois cents ans et a été suivi
d’innombrables autres -- et l’isolement génétique est annulé par le régime
de fécondation croisée commun à toutes les populations de sapin pectiné.
Cependant, il s’est ainsi créé un mythe du sapin de Nordmann, à partir
duquel on développera une propagande qui ira jusqu’à recommander son emploi
exclusif comme conifère dans la forêt de l’Aigoual, ceci en l’absence de
toute base expérimentale. Parallèlement sera entreprise une sélection du
Nordmann dont on veut espérer que, les flux polliniques aidant, elle n’altérera
pas gravement la valeur générale de l’écotype. Enfin sans attendre les résultats
de la sélection qui pourraient être longs à venir, voire peu conformes aux
espérances, des semences provenant de peuplements dits « classés »
seront mises à la disposition de pépiniéristes réglementairement identifiés,
qui, par ailleurs, ne seront jamais en état de subvenir aux besoins normaux de
la forêt. Le système, toutefois, s’opposera fermement au recours à
d’autres sources de matériel végétal, interdisant toute préparation de
l’avenir par les plus timides essais de
terrain.
On peut raconter d’autres histoires, aux conclusions analogues ou
inverses. C’est, par exemple, pour rester dans le riche domaine du sapin, un
M. Boissier qui découvre – ou s’aperçoit qu’on a
découvert -- dans un recoin montagneux du sud de l’Espagne, un sapin
pectiné dont il tient à faire une nouvelle espèce, Abies
pinsapo Bois., qui ne résiste guère au gel dans nos montagnes mais
pourrait peut-être rendre des services ailleurs. M. Boissier aurait dû
s’attacher à en connaître. Il ne l’a pas fait et il ne semble pas que
personne l’ait fait à sa place.
On pourrait encore citer, pour mémoire, Abies
cephalonica Loud., de Grèce, Abies
bornmuelleriana Mattf., un peu compatriote du Nordmann et lui ressemblant
beaucoup, au moins pour le profane, d’Abies
numidica de Lannoy, trouvé un peu par hasard en Algérie et de la
demi-douzaine d’autres « espèces », parfois réputées être
« hybrides » les unes des autres, dont je ne saurais donner
les noms complets des savants auxquels
nous devons leurs descriptions. Le grand botaniste et généticien russe Vavilov,
qui fût envoyé en Sibérie pour n’avoir pas adhéré avec suffisamment
d’enthousiasme à la génétique soviétique, disait que « l’espèce
est un tout morphophysiologique distinct, complexe et variable, relié dans sa
genèse à un milieu physique et à une aire géographique déterminés ».
Je vois mal comment le sapin pectiné pourrait, à la seule lumière des traitements que lui ont fait subir les « spécialistes
compétents » de sa taxinomie, échapper à cette définition.
Flahault, nous l’avons dit, n’était pas prêt à assimiler la génétique
des populations. Il eut facilement admis d’affirmer que l’espèce était
distincte mais, peu ou pas intéressé par sa genèse, c’est sa réalité matérielle,
achevée, qu’il entendait relier au milieu. Surtout, il ne la considérait pas
comme variable. Comme avec Darwin, il admettait que les espèces naissent –
prennent origine – par sélection naturelle. Il n’admettait pas que l’évolution
fait se succéder les formes de la même manière entre les espèces qu’à
l’intérieur de la même espèce, la seule particularité du niveau spécifique
étant l’isolement de la lignée par apparition de barrières à l’interfécondation.
Fondamentalement, il resta créationniste. Il n’eut pas l’occasion de
comprendre que l’adaptation est non pas une situation
mais le mécanisme par lequel l’espèce
forme des écotypes, que l’adaptation existe tellement qu’elle explique l’évolution.
C’est dès les années 1900 qu’on trouve sous sa plume, peut-être seulement
dans des notes personnelles, l’affirmation dont il voulut faire son testament
scientifique : « Nous n’acclimatons pas ». Il veut exprimer
par là sa conviction que la plante est liée au climat, avant tout autre
facteur, de façon inaltérable, sans que le non-inné puisse être transmis à
la descendance. Or, ceci est vrai pour l’individu mais non pour la population,
encore moins pour l’espèce, qui s’adapte incontestablement, en faisant des
écotypes. Entre les écotypes pourront du reste se former, après quelques
dizaines ou centaines de générations, des barrières à l’interfécondation
qui en feront, éventuellement, des espèces.
Il ne pouvait y avoir de conflit sur ce point entre le botaniste et le
forestier, qui ne connaissait guère que l’essence, laquelle correspond bien
à l’espèce de l’utilisateur que, pour moi, défendait Pourtet. Ne lui
donnant pas de nom latin, il évitait toute discussion. Il ne devait pas être gêné
par la distinction entre le pin de Corse et le pin d’Autriche, qu’il devait
identifier, comme nous le faisons, par l’aspect de l’écorce. Tous deux étaient
pour lui des pins Laricio mais la hiérarchie systématique ne le souciait guère.
Une telle attitude suppose, bien sûr, qu’on ne manipule qu’un nombre limité
… d’essences. Il n’y en a que onze, pour les conifères, sur le « tableau
synoptique ».
Le
jardinier du Jardin de Dieu
Scientifiquement, on ne voit pas ce qui aurait pu séparer
le forestier géologue et le botaniste cartographe. On ne voit pas
davantage ce qui, toujours scientifiquement, les poussa à associer leurs
efforts dans une œuvre expérimentale exemplaire.
On peut se demander si ce que Flahault admira d’abord en Fabre – plus
âgé que lui de huit ans -- ne fût pas l’humaniste. Il avait rêvé de faire
la carte botanique d’un pays inhabité, où personne, du moins, n’aurait eu
d’accent désagréable à ses oreilles. Fabre, lui, pour reboiser, avait
appris le patois. Il n’en avait pas suivi des cours à l’Ecole
Polytechnique. Il n’est pas de cours pour enseigner l’amour des autres.
Flahault le savait certainement mais peut-être Fabre, à leur rencontre, en
avait-il plus d’expérience. Jeune et aimable, à quarante-huit ans, il l’était
certainement resté – en profondeur. Pourrait-on dire que Flahault en fût séduit ?
Après tout, quel mal y aurait-il eu ?
Cette possible séduction aurait-elle été réciproque ? Fabre a pu
être « fasciné », lui aussi par la forme de l’enseignement de
Flahault, au-delà de l’intérêt qu’il en éprouvait pour le fond. Ainsi
s’expliquerait l’attitude d’élève qu’il adopta vis-à-vis du savant,
suivant ses herborisations au milieu des étudiants. Là encore, faute de
raisons, tant scientifiques que techniques, pour lesquelles des connaissances de
botanique approfondies lui auraient manqué, je risquerais volontiers une autre
hypothèse : Fabre fût suffisamment naïf pour croire qu’il atténuerait
la réputation d’imprudence qu’il commençait à avoir s’il pouvait
convaincre son administration de lui donner un « tuteur » hautement
spécialisé.
Il y parvint – difficilement. Il obtint pour son ami, en 1902, une
mission officielle, que l’on assortit d’une subvention de 400 fr, dont le
caractère non renouvelable était précisé avec un soin particulier. Du moins
pensait-il pouvoir l’aider de ses moyens propres. Or, dans un service
traditionnellement sévère quant à l’observation des limites des compétences,
n’y avait-il pas, là encore, un
risque d’être taxé, pour le moins, d’imprudence ?
Une note manuscrite, signée de lui et datée de 1904 demande à M. l’Inspecteur
des. Eaux et Forêts de Nîmes Ouest de « donner immédiatement au Garde Général,
aux brigadiers et aux gardes des instructions leur enjoignant de fournir à M.
Flahault leur concours le plus empressé et de mettre à sa disposition le
nombre d’ouvriers de choix – sic ? -- dont il aura besoin ».
Tout cela est-il vraiment nécessaire
à « des observations suivies sur la vie des végétaux dans leurs
rapports avec le climat » suivant les termes de la mission de 1902 ?
Cette note, venant deux ans après l’attribution d’une aide financière dérisoire,
ne traduirait-elle pas l’existence de tensions, conséquence, voire origine,
de « remous » administratifs dangereux ?
L’historien est heureux, lorsqu’il a fait la part de telles
incertitudes, de pouvoir s’appuyer sur des faits. La collaboration de Flahault
et de Fabre recouvre la création des arboretums de l’Aigoual.
Lorsqu’en 1872 Fabre prit son premier poste, il n’existait pas de pépinières
capables de fournir un nombre de plants d’arbres forestiers suffisant pour des
reboisements de centaines, voire de milliers d’hectares. Il fallait donc
produire ces plants. Les graines que Fabre recevait de son administration –
graines de pin sylvestre, en particulier, seule espèce de pin indiscutablement
chez elle dans le pays – germaient mal, sans doute faute de soins dans la préparation.
Nous avons dit qu’il savait, au moins intuitivement, que, pour une essence
donnée, les graines qui tombent sur place sont, génétiquement, les meilleures
possibles, puisque sélectionnées par le milieu auquel elles sont destinées.
La tradition sylvicole les recommande de préférence à toutes autres. Il décida
donc de les utiliser exclusivement pour toutes
les plantations. Il semble que ce soit à Saint Sauveur – 900 m -- acquis en
1882, que fût installée la pépinière qui produisit la plus grosse masse des
plants utilisés pour l’ensemble de l’œuvre. On peut donc penser qu’ils
étaient botaniquement indigènes et
particulièrement indiqués pour être comparés à tout ce qui pouvait être introduit.
Saint Sauveur, devenu domanial, remplissait les conditions pour y « essayer
l’introduction d’essences étrangères au pays », ce qui fut fait à
partir de 1889. Puechagut – 1050 m – et ses célèbres séquoias
suivirent en 1890.
En obtenant, en 1902, une mission
officielle pour Flahault, Fabre pensait, certainement, cette fois, établir un
arboretum à 1300 m pour continuer,
pour ses plantations d’essais, une progression en altitude et une
diversification des sols comme des expositions. Flahault fut là un
conseiller mais aussi un exécutant fidèle, précieux par son attachement à la
rigueur des expériences, chacune ayant les autres pour indispensables témoins.
(Ce fût sa façon de « faire des répétitions », façon qui ne
peut évidemment pas satisfaire les expérimentateurs modernes faute d’avoir
respecté les méthodes statistiques qui permettront, dans cent ans, ce que les
arboretums actuels ne permettent pas – si, toutefois, les expérimentateurs
qui seront alors en fonctions veulent bien considérer, contrairement à ce que
considèrent leurs prédécesseurs, que ces méthodes modernes le seront
toujours suffisamment). Les plantations montent jusqu’à 1550 m en allant du
laboratoire à l’Aigoual et il établit, en 1904, un arboretum à 200 m, près
de Ganges, entre la Vis et la route de Gorniès. Canayères – 800 m –
au-dessus de Trèves, est établi en 1903, Cazebonne – 590 m – près d’Alzon,
en 1903 également. C’est, maintenant, l’un des plus intéressants par
l’ampleur de la surface de montagne pour laquelle il peut fournir des
indications et par les essais qui y sont poursuivis. Dans une perspective d’« élimination »,
quelques conifères et des bouleaux furent plantés dans la molière du Trévezel,
non loin de la Séreyrède.
Dans cet ensemble, l’arboretum de la Foux occupe une place un peu
particulière. Les plantations ont commencé en 1900, avant Flahault. Celui-ci
paraît y admirer les « résultats…remarquables obtenus pour beaucoup
d’espèces ». Il a été taillé dans une très belle propriété --
achetée pour 60 000 francs or, dit la légende locale, à un propriétaire qui
les investit dans les emprunts russes pour se recycler, par la suite, dans une
forme très rudimentaire de coiffure pour Messieurs. Son utilité expérimentale
se conçoit plutôt mal. Il jouxte Saint Sauveur mais sa fertilité est très
supérieure : on a dit que la culture maraîchère y serait plus indiquée
que la sylviculture. La recherche, pourrait-on penser, se concevrait mieux dans
un environnement plus sévère. On pourrait aussi penser le contraire, puisque
les effets de deux fertilités différentes pourraient y être comparés. Vers
la fin des années 1950, un sapin de Vancouver y fut remarqué pour un
accroissement annuel de taille allant jusqu’à un mètre. Ce fut probablement
la seule occasion ou les arboretums de l’Aigoual provoquèrent un enthousiasme
diversificateur, qu’il fallut calmer en révélant que la valeur technologique
de l’espèce était en question. La Foux garde tout son intérêt, toutefois,
comme pôle d’attraction touristique et c’est avec raison que des panneaux
ont été installés à l’entrée, rappelant la phrase de Fabre sur l’intérêt
des essais d’essences exotiques au cœur même de la zone où les « écologistes »
les ont réglementairement prohibés.
Il paraît certain que, dans la pensée de Fabre, l’Hort de Dieu ne
devait pas être seulement un arboretum. Il devait être convaincu que l’idée
d’un lieu de travaux mais aussi de détente à l’abri des chaleurs estivales
montpelliéraines pourrait contribuer à séduire et « fixer »
l’itinérant qu’était son ami. Avant 1907, date à laquelle l’Hort de
Dieu devint habitable, il organisa pour lui des vacances dans diverses maisons
forestières ce qui, déjà, prêtait à critique. Pour des raisons que nous
pouvons désormais comprendre, ces établissements étaient soumis à une réglementation
très stricte. La disparition, dans le matériel de cuisine, d’une petite
cuiller – sic -- avait autant d’importance, par la façon dont elle
intervenait dans la vie administrative de la circonscription, qu’une irrégularité
dans une vente de bois. Y introduire pour des vacances des personnes étrangères
au service risquait d’aboutir à de graves complications. Les Flahault, en
attendant d’être installés « dans leurs meubles », firent
pourtant des séjours d’été à la Sereyrède, à Saint Sauveur, à Puechagut,
peut-être à Montals. Dans chacune de ces sévères demeures, Madame Flahault,
qui avait un joli brin de pinceau, décorait une porte -- au moins – d’un
bouquet de digitales. La dernière porte décorée fût, celle, toute neuve, du
« laboratoire », la pièce studieuse du chalet de l’Hort de Dieu,
occupé pour la première fois en 1907.
L’Hort Diou, le Jardin de Dieu. Dieu seul méritait -- pendant les deux
mois d’un bref printemps mais il s’en contentait -- une telle offrande de
fleurs. Cette diversité horticole – il n’y avait pas d’autre mot – Dieu
l’avait obtenue en exposant au soleil de l’après midi une sorte de livre,
ouvert entre deux pages d’entassements caillouteux. Dans la massive bâtisse
en ruine transformée en coquet
petit laboratoire de montagne, Flahault accueillit chaque année, de 1907 à
1914, dès les premiers jours de juin jusqu’à la rentrée des facultés, des
étudiants, des collègues naturalistes ou géographes, des botanistes amateurs,
parfois des visiteurs étrangers plus ou moins illustres. Jusqu’à une dizaine
de personnes occupaient les lieux, couchant, au besoin, dans le cabinet photo ou
dans l’escalier, un escalier fort confortable, à vrai dire, comme prédestiné
à faire une pièce d’appoint « multi-usage ».
La réalisation du laboratoire n’aurait pas été possible sans
l’aide des forestiers. Les chantiers que Fabre mit à la disposition de
Flahault pour les plantations étaient probablement gérés de façon assez
souple pour permettre leur utilisation dans la restauration du gros œuvre.
J’y ai déjà fait allusion. Le reste – aménagement, ameublement,
installations diverses et fonctionnement, y compris l’entretien des étudiants
– fût financé par la somptueuse et non renouvelable subvention de 400 fr de
la Direction des Eaux et Forêts, par un total de 4.015,80 fr alloués par l’Université
de Montpellier et par 12.949 fr offerts par des « amis personnels ».
Flahault, qui ne manqua pas de citer ces chiffres dans toute leur précision,
avouait volontiers, en outre, que l’Hort de Dieu « lui coûtait deux
mille francs par an », soit, sans doute, non loin du cinquième de son
traitement. Il faisait volontiers cet aveu. Mettre son argent dans la réalisation
d’un rêve n’est pas difficile. En tout état de cause, ces chiffres
permettent de penser que, de 1907 à la guerre, le budget annuel – estival,
plutôt -- de l’Hort de Dieu fût de l’ordre de 4 000 francs or, soit
d’environ 80 à 100 000 de nos francs lourds,
dont 10 à 12 % provenant de l’administration.
Au lancement du laboratoire, le gros des plantations était achevé. Cela
dut être un travail considérable. Les amoncellements de cailloux et de rochers
qui constituaient les 20 hectares du « cirque » -- seulement garnis
de quelques dizaines de vieux hêtres échappés des massacres du déboisement
-- n’avaient, en surface, que peu de terre Il fallait souvent en apporter dans
un panier pour y placer le jeune plant. Or, c’est plusieurs milliers de jeunes
arbres qui furent plantés, dont quelque quinze cent pour les seuls sapins.
Beaucoup des jeunes plants provenaient de la pépinière installée près du
chalet. Il fallait arroser tout cela, en attendant que les racines se développent
suffisamment. Un barrage fut établi, un réseau d’irrigation créé. Des
sentiers furent tracés, qu’il fallut entretenir. Flahault courait d’un
ouvrier à l’autre pour remettre les plants en
évitant la moindre erreur, rectifier le tracé d’un sentier,
surveiller un arrosage, sans oublier de noter une observation ou de prendre une
photographie. Il n’herborisait plus – faute de temps seulement, bien sûr
mais peut-être aussi parce qu’il avait enfin retrouvé sa vocation première,
le moule véritable de sa communion d’idées et de sentiments avec sa mère.
Il était redevenu jardinier, le jardinier du Jardin de Dieu.
Je trouve très significatif que la « deuxième lettre » soit
précisément datée de cette période. Ce que pensait de la science
l’excellente dame n’était pas, jusque là, très important. Il ne peut plus
en être de même. Quoiqu’il pense au juste de l’évolution, l’évolution
est un fait, qui s’impose depuis longtemps au savant qu’il est. Darwin
a-t-il raison dans le détail de son œuvre ? Ce n’est pas l’important.
Darwin refuse la superstition, tout comme le font les théologiens. A celle à
qui il doit tant, Charles Flahault n’a guère parlé, jusqu’ici, de son
métier mais il l’a toujours tenue informée de ses joies comme de ses
peines, de sa vie affective véritable et c’est là qu’il en est, désormais.
Il ne peut laisser passer de sa part une condamnation de l’évolutionnisme qui
n’est plus que superstitieuse. Il réagit à sa manière avec elle, la manière
de 1874. Il lui « bourre le crâne » mais en sens inverse :
Darwin est un profond philosophe desservi par des traducteurs malhonnêtes. Quant
à ce vilain mécréant de Lamarck, n’en laisser subsister qu’un docte
successeur de Linné, pourquoi pas ? Dieu y retrouvera les siens. Il
n’est d’ailleurs que de comparer les deux écritures : n’a-t-elle pas
plus de vérité chez celui qui sait
et siégera bientôt à l’Académie que dans l’italique tout juste soignée
du bachelier ?
Après 1907, Flahault continue à planter mais en généralisant
largement ses activités. Il partage avec Fabre l’idée que rien de ce que
l’on peut faire pousser, forêt, cultures, pâturages, ne doit être négligé,
car étant susceptible d’apporter un supplément de confort à l’homme. Il
plante des arbres forestiers mais fait aussi de modestes essais
d’arboriculture fruitière – un poirier, groseilliers divers. Il plante des
rosiers et apporte des roses à une famille amie, le dimanche, en allant à la
messe. Il sème des légumes,
salades, radis et note, dans des registres, les dates de semis et de levée…
Il se procure des mélanges pastoraux de montagne, des Alpes, de l’Himalaya.
Deux placeaux leurs sont consacrés. Ils attendent qu’un spécialiste des
graminées vienne constater ce qu’il en est advenu.
A une centaine de mètres vers l’est du laboratoire, dans un creux
d’une cinquantaine de mètres de diamètre parfaitement abrité et tourné
vers le couchant, Flahault redonne aussi la parole aux plantes sauvages :
il y installe des espèces pérennes basses qu’il reçoit des diverses régions
montagneuses de France. Au cours des années 1950, nous avons fait, avec des
botanistes de Nancy et de Montpellier un inventaire des espèces ayant subsisté,
soit quelques dizaines, à peu près toutes plantes d’ombre, évidemment. La
liste en montre clairement les affinités pyrénéennes de l’Aigoual. Deux espèces
des Pyrénées, un lys et un panicot, se sont évadées et ont envahi
l’arboretum. Le premier se comporte toujours bien, le second a disparu une
dizaine d’années plus tard, après que le développement des arbres eut fait
de l’arboretum une forêt.
Devenu reproducteur de plantes, Flahault a enfin l’idée de réaliser
une véritable expérience de laboratoire. Il s’était arrêté, en 1874, sur
ce semis de Rhodanthe maculata Thomps, effectué par un collègue nordique à 60
et 70° de latitude et donnant, au Nord, des fleurs beaucoup plus éclatantes,
ceci dès la première année. Il
jugeait ce résultat « très intéressant » mais n’avait pas les
moyens de l’interpréter. Il en faisait une preuve de la réalité de l’espèce.
Il n’aurait pas eu, alors, l’idée de reprendre de telles expériences. Cela
n’entrait pas dans son métier. Les
choses ont changé. Il a vu, dans les Alpes de Dalmatie, sur les crêtes battues
par des vents violents, des pins spontanés, qu’on lui a présentés comme
appartenant à l’espèce Pinus mughus Scopoli,
et qui lui parurent être des voisins du pin montagnard – le fameux pin à
crochets, pionnier des conifères du reboisement, à tendances volontiers
rampantes, lui aussi, à l’occasion. Il met en place dans un endroit
relativement abrité de l’arboretum, à l’automne 1905 – année de la
deuxième lettre, remarquons-le sans hésiter – des plants issus de graines récoltées
sur place, demandés à la station de Mariabrunn, en Autriche. Les plantes, au
cours de cette première génération de reproduction gardent, cette fois, leur
port rampant d’origine. On peut toujours le constater. En entrant dans
l’arboretum par le sentier dit de l’Observatoire, juste après avoir croisé
le sentier horizontal – à ne pas confondre avec le chemin forestier récent
que l’on a croisé plus haut, qui part du même sentier horizontal, au nord de
l’arboretum, pour aller vers le sentier de 4 000 marches – on trouve, à
gauche, les plants introduits, toujours rampants, à droite un pin sylvestre
d’assez belle venue. Il y a donc un témoin – brevet d’expérimentateur
pour le « naturaliste », ce
qui ne rend pas l’interprétation plus facile. Le commentaire traditionnel est
que l’expérience montre qu’il ne s’agit pas du même taxon. Certes mais
les petits pois ronds et ridés de Mendel n’appartenaient pas non plus, eux,
au même taxon, peut-on penser …Flahault ne peut aller plus loin, faute
d’admettre l’importance – et de comprendre la nature particulaire -- de la
variabilité intraspécifique, comme la part, dans l’hérédité, de l’inné
et du non-inné.
Sur ce point au moins, il reste insatisfait et refait l’expérience en
1911. Cette fois, il place les plants reçus dans un des endroits les plus abrités.
Il n’en sera guère plus avancé : les arbres restent vigoureux mais
rampants Il n’aura jamais l’occasion d’admettre que l’espèce
d’origine, dressée, a formé un écotype rampant qui met sa réalité en
cause. Il se peut pourtant qu’il en ait tiré une confiance plus grande en
l’idée que « le résultat de l’entraînement ne peut être transféré
à l’hérédité », que le non-inné n’est pas transmissible. Ce
serait alors de cela aussi qu’il
aurait voulu me parler lors de notre dernière conversation, avec un certain désenchantement,
puisque ce serait alors une généralisation très légitime de sa formule :
«Nous n’acclimatons pas ».
L ’essentiel n’est pourtant pas là. L’essentiel, c’est que
le jardinier devait étendre son art à l’architecture paysagiste, à la
disposition des essais et que c’est là qu’il laissa éclater en même temps
sa culture, son expérience propre du message de Fabre et ce qu’il faut bien
appeler son génie à la fois de biologiste et d’enseignant.
Un ravin divise l’arboretum en deux, pour rejoindre, au sud, le valat
de l’Hort de Dieu. Flahault lui donne le nom de Ravin de Thunberg, du nom
d’un biologiste sans doute célèbre et dont chacun sait ou doit savoir la biographie comme les services qu’il a rendus à la
science, ce qu’il est donc inutile de rappeler. A l’ouest, le Nouveau
Continent, à l’est, l’Ancien. A une ou deux erreurs techniques près, les
plantations faites dans l’arboretum, par Flahault mais aussi après lui,
respectèrent toujours ce schéma ; il y en eut, du moins tant que
l’ancien service de recherches forestières exista et j’ai assisté à la préparation
des dernières en 1961.
A l’ouest, cinq espèces de sapins de fort belle venue semblent « s’être acclimatées »,
comme il ne faut plus dire en attendant qu’on nous dise comment il faut les déclarer
« acclimatées à l’avance ». Elles se reproduisent en restant,
semble-t-il, bien distinctes. L’une d’elles est d’ailleurs largement
utilisée en décoration dans les parcs et jardins. Des resemis d’une autre,
le fameux sapin noble, auraient été « braconnés » par des propriétaires
privés et leur auraient donné d’excellents résultats, soigneusement tenus
secrets, bien sûr. Toutes auraient manifestement dû être mises en essais
d’ampleur raisonnable au cours des reboisements dans le nouveau système. Les responsables actuels de la recherche
et de la vulgarisation semblent bien s’être opposés à toute action de cette
nature. Pour préparer cependant l’avenir de façon, cette fois, vraiment
scientifique, ont été mis en place des essais d’amélioration de deux
d’entre elles, choisies, de préférence aux autres, on ne sait pas trop
pourquoi. « D’autres, qui devraient savoir, prétendent faire des expériences
mais elles ont été répétées bien des fois … nous aurions voulu leur épargner
ces sottises ; mais ceux-là ne demandent pas conseil [préférant se
lancer dans des] opérations aussi vaines qu’onéreuses ». Au fait, qui
donc, en 1934, porte ce jugement et sur qui ?
A l’Est, notre bon vieux sapin pectiné figure modestement. Je ne suis
pas en état de dire quel est l’écotype présent. Il y en a, me dit-on,
plusieurs – des Vosges, de l’Aude – que les spécialistes reconnaissent
aussi facilement que s’ils portaient des noms latins différents. Ici, les
noms latins abondent : les Abies peuvent encore être bornmulleriana,
cephalonica, nordmanniana et j’en arrête ici la liste alphabétique,
s’agissant d’«espèces » toutes parfaitement interfécondes, en fait
manifestement écotypes de pectiné, introduits et réintroduits depuis deux
cents ans par les Vilmorin et autres pépiniéristes, longtemps seuls à s’être
occupé de botanique forestière en France. Les nombreux resemis, qui
fructifient et se resèment eux-mêmes, depuis longtemps maintenant, formeront,
quand les prototypes seront morts, un nouvel Abies
auquel on pourra donner un nouveau nom d’espèce et que les spécialistes
sauront déterminer et distinguer des autres par des caractères morphologiques.
Ce sera, en fait, un nouvel écotype de sapin pectiné, ce qu’il y aura de
mieux, génétiquement, puisque bénéficiant de la sélection naturelle, donc
bien adapté localement. On peut même commencer tout de suite, pour gagner du
temps : les choses suivront leur cours.. Cela vaudra mieux que de continuer
à recommander exclusivement le sapin de Nordmann, issu de peuplements dits
« classés », les mêmes pour l’ensemble de la forêt française.
Toutefois, il ne faut pas en attendre la diversité génétique prônée par les
revues spécialisée. Si cette diversité est désirable, il faut la rechercher
dans des contrées botaniquement riches et compléter, par de vraies
espèces introduites, le futur Abies
monsaquatilis – à décrire.
La constitution et l’amélioration de la forêt exigent des essences
adaptées, certes mais nombreuses, parce que sont nombreuses les situations
qu’elles doivent affronter. La forêt est diverse, la forêt de montagne plus
que tout autre. A chaque altitude, la quantité de lumière et les qualités du
sol sont irrégulièrement distribuées. L’ingénieur, le technicien,
l’ouvrier – ce dernier au moins autant que les autres – doivent, quand ils
reboisent, disposer d’une gamme de constituants et savoir les doser dans
chacune des situations rencontrées, infiniment variables. Cette stratégie doit
encore tenir compte de la menace des prédateurs divers, de la méthode adoptée
pour la conduite de la forêt, comme des débouchés économiques facteurs aussi
importants mais imprévisibles. L’essence unique, conduite en futaie régulière
– à la manière des forêts de chênes destinées par Colbert à pourvoir aux
besoins de la marine de
guerre – est de plus en plus critiquée par les forestiers. On ne montre même
plus, à l’Aigoual, de hêtraie pure que comme pièce de collection. Hêtraie-sapinière
pourquoi pas ? Que cette sapinière doive être monospécifique,
certainement non. Qu’elle doive être monovariétale, établie à partir de sélections,
en parler avant que l’excellence de la méthode ait été expérimentalement démontrée
me paraîtrait bien peu sage.
Il n’est pas besoin de dire – même si on pense qu’il vaut mieux le
faire -- que l’introduction doit être suivie de l’élimination, en
conditions spécialisées au besoin, des espèces clairement inadaptées. Il
est, hélas, tout à fait nécessaire de préciser que l’étape suivante ne
doit pas être la généralisation sans précaution et sans nécessité d’un
quelconque Douglas, dont l’utilisation relève de la mode, non de quelque impératif
technique – même si le Douglas quelconque se trouve avoir rendu des services.
Un sage a proposé récemment de planter, dans chaque parcelle reboisée, 2% de
sujets d’une espèce exotique nouvelle ayant passé l’épreuve de
l’arboretum d’élimination. Comme toujours en face d’un progrès, le refus
est venu, d’un coté des forces de conservation, de l’autre des « recommenceurs »
d’expériences qui ne demandent pas de conseils dont parlait Flahault quelques
mois avant sa mort. Le stade de transfert des connaissances « du
laboratoire à l’usine » manque quasi totalement à la sylviculture
européenne. Il risque aujourd’hui de manquer particulièrement à la
sylviculture française.
Un jeune forestier canadien, que j’avais mis en contact avec un voisin,
forestier un peu marginal mais de quelque compétence, lui disait qu’il lui
semblait que notre génétique forestière n’est pas à la hauteur de la précision
de nos martelages. A moi, il ne le dit pas le voisin me le répéta. J’en fus
conforté dans l’idée que, nouveau venu dans la forêt, je ne voyais pas y
faire, en matière d’amélioration d’arbres, qui sont des plantes sauvages,
ce qui m’avait été recommandé au début de ma carrière pour les plantes
domestiques. Le succès n’y est assuré que sous la double condition de
rechercher à l’extérieur ce qu’on ne trouve pas ou qu’on ne trouve que
difficilement sur place et de vérifier le bien fondé du résultat. Le jeune
forestier me l’aurait dit si j’étais allé le voir au Canada. Fabre n’a
pas dû négliger ce qu’il apprenait dans ses voyages à l’étranger. Il en
a certainement fait venir des idées en même temps que des graines d’espèces
exotiques. Ce n’est qu’ainsi qu’il a pu accomplir une œuvre qui exigeait
d’abord d’ouvrir la forêt au monde.
Flahault, pour sa part, en géographe, savait qu’une échelle
cartographique n’est pas seulement le rapport des dimensions de la représentation
et du représenté, que c’est aussi une manière de penser. Les méthodes de
Fabre lui avaient paru logiques et efficaces. Il sut, à l’Hort de Dieu, faire
une éclatante démonstration de leur valeur. Leur application ne lui
appartenait pas.
Une
tempête de retard
Guinier, dans la notice nécrologique qu’il consacra à Flahault,
raconte qu’un forestier montpelliérain, auquel il avait écrit pour lui
annoncer la disparition de leur ami, lui répondit par une lettre où il disait
de lui : « Il était devenu aussi forestier que n’importe lequel
d’entre nous ».
Je ne peux pas m’empêcher de penser que le correspondant de Guinier,
comme « n’importe lequel » de ses camarades départementaux,
trouvait, nonobstant l’affection collégiale que tous lui portaient
certainement, que Flahault était devenu un
peu trop forestier. Ces camarades savaient que le travail de Restauration de
la Forêt en Montagne est difficile. L’exemple de Fabre montrait qu’il n’était
pas suffisant d’y exceller pour terminer tranquillement sa carrière. Ils
revenaient presque tous de la guerre. Les forestiers sont des fonctionnaires armés,
aubaine, en temps de guerre, pour les consommateurs de chair à canon. Aussi
revenaient-ils peu nombreux.
On leur envoyait en renfort des nouveaux, recrutés à la hâte. Ils n’avaient
nulle envie de faire de l’expérimentation, fût-elle de terrain. Quand ils
plantaient, ils ne le faisaient guère sans s’assurer que, dans le voisinage,
des boisements utilisant les essences qu’ils prévoyaient avaient été réussis.
Faute de pouvoir leur faire officiellement des recommandations, ce qui n’eut
pas été toléré, Flahault ne cessait de les harceler avec les arboretums, sa
marotte. Il les obligeait à l’y accompagner au moins une fois par an – Max
Nègre dit l’avoir fait dans les toutes dernières des années trente. Il n’écrivait
plus que pour prôner, à l’intention des planteurs – privés, pouvait-on
admettre – l’emploi des essences exotiques. Il ne fut guère entendu.
« Les cèdres » doit être l’une de ses toutes dernières
publications. Elle est datée de 1934. On me dit que les effets n’en ont pas
été négligeables. Qu’aurait-il fallu pour que ce n’ait pas été une
exception ?
Peut-être une tempête, le 27 décembre 34, par exemple. « Le
Monde », s’il avait existé, aurait publié, une dizaine de jours après,
sous la signature de quelque journaliste à tout faire, un article sans guère
de contenu mais au titre inspiré, quelque chose comme : « La
reconstitution de la forêt passe par la diversification des essences ».
On se serait vite aperçu qu’elle passait d’abord par l’acceptation de
faire flèche de tout bois et de renoncer – au moins pour quelques dizaines
d’années -- aux réglementations arbitraires, réglementations commerciales,
génétiques ou administratives qui brident les initiatives et dilapident les
moyens. Qu’elle passait aussi par l’interdiction de pénétrer dans la forêt
faite à ceux qui, cherchant le pouvoir sous prétexte de protéger une
nature dont ils seraient bien en peine de dire ce qu’elle est, veulent en
chasser l’homme. Flahault aurait été associé à un programme de reboisement
expérimental. Un peu plus tard, on lui aurait rendu un hommage plus fervent que
la seule récupération, pour pose d’une plaque et d’un médaillon, d’un
monument qu’il ne s’était pas destiné. La création, par exemple, d’un
Laboratoire Charles Flahault, doté de véritables moyens de travail, ouvert à
tous ceux qui aiment la forêt et qui veulent en apprendre quelque chose.
Il n’y a pas eu de tempête.
*
Aux temps néolithiques – il
y a quelque dix mille ans, peut-être – notre forêt à nous était habitée.
Elle n’a cessé de l’être depuis. Ses habitants vivaient de la forêt, la
forêt vivait d’eux et il en est toujours ainsi.
Ceux qui étudient les couches géologiques formées, au moins pour
partie, par les dépôts de pollen fossiles nous ont appris que la forêt de
l’Aigoual fut, il y a de cinq à dix
mille ans, de bouleaux. Les chênes les remplacèrent pour faire une place aux
sapins qui finirent par prendre le dessus pour
s’effacer eux-mêmes devant les hêtres. Il y a cent cinquante ans, il
ne restait plus de ceux-ci que quelques survivants éparpillés, oubliés par
les exigences en énergie des industries
naissantes, lorsque les habitants, privés, souvent de leur propre fait, de
leurs moyens d’existence, commencèrent à s’enfuir. Les plus courageux,
toutefois, restèrent. On leur donna les moyens, des moyens mesurés mais
efficaces, de reprendre le dialogue. Le dialogue reprit et la forêt recommença
à vivre. Cette histoire est celle de nombreuses introductions de toutes sortes,
voulues ou non par l’homme. Du nouveau en organismes à tous les niveaux de la
systématique et du type biologique, animaux et végétaux, arbres et plantes
basses, nouvelles espèces, nouvelles races, nouveaux gènes. Des climats
capables de changer, de façon significative pour les arbres, en quelques siècles
– guère plus que leur durée de vie. De nouveaux habitants, souvent, avec de
nouvelles idées. Tout ceci, depuis la préhistoire. La forêt
habitée ne peut vivre que de renouvellement. N’en serait-il pas de même
d’ailleurs, de toute la biosphère ?
Remerciements
Je ne puis diffuser ces réflexions sans, d’abord, saluer ici la mémoire
de Louis Emberger, professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier, qui
fut mon maître lorsque je suis venu chercher à l’Université les rudiments
d’ humanisme qu’elle était seule capable de me donner. J’obtins de lui,
presque à la veille de la mobilisation de 1939, au vieil Institut de Botanique
que je ne devais plus revoir, le diplôme que mes parents avaient obtenu de
Charles Flahault, un tiers de siècle plus tôt. Très au-delà de nos rapports
professionnels et des services que nous avons pu nous rendre, en Tunisie et en
France, c’est notre commune admiration pour ce dernier qui l’a amené, en
1951, à me proposer de devenir « l’ermite d’été de l’Hort de Dieu »
que je suis resté pendant plus de trente cinq ans. Sans les visites et les différents
contacts que ces séjours m’ont valu, l’analyse précédente n’aurait pu
être faite.
J’ai dit le bien que je pensais de l’ouvrage que Monsieur Jean-Marie
Emberger a consacré à faire connaître l’aspect humain, combien attachant,
de la personnalité de son grand-père. Je le remercie de m’avoir communiqué
les photocopies des lettres dont je cite des extraits. J’ai, par ailleurs,
recueilli de précieuses informations à l’exposition
qu’il a organisée en juillet 99, avec Madame Flahault-Ordronneau et
Monsieur Benoît Garrone, de l’Institut de Botanique de Montpellier, à
l’occasion de l’inauguration de
l’Avenue Charles Flahault à l’Espérou,.
A l’Hort de Dieu, j’ai toujours été accueilli avec beaucoup de
bienveillance par les différents représentants de l’administration des Forêts
qui m’y ont « hébergé ». Je dois, cependant, manifester tout
particulièrement ma reconnaissance à M. Georges de Maupeou, actuel Directeur Régional
de l’O.N.F., qui, récemment, ne m’a pas ménagé son aide, pas plus que
celle de ses services, dans ma tentative de dépasser, à l’Aigoual, mon
statut de fonctionnaire retraité en apportant quelques éléments de réflexion
susceptibles d’être utiles à l’histoire de la botanique forestière.
Je remercie pour son aide M. Joel Mathez, Maître de Conférences à l’Université
Montpellier II. Les recherches qu’il mène au nouvel Institut de Botanique sur
la taxinomie expérimentale des Valérianacées sont une nouvelle confirmation
de la richesse botanique du Nouveau Continent soulignée par Flahault. Il est étonné,
m’écrit-il, qu’en dehors de ce qui concerne l’algologie, « l’Institut
de Botanique conserve si peu de traces des activités scientifiques » de
son fondateur.
Je regrette de ne citer qu’en passant ceux qui, par leur aide, ont pris
part sous des formes diverses à l’élaboration de ce texte : M. Jacques
Grelu, Ingénieur en chef du Génie Rural et des Eaux et Forêts, Mlle Lionnet,
bibliothécaire E.N.G.R.E.F.-Nancy, M. Georges Roux, Agent Technique de l’O.N.F.,
M. Robert Rouzier, forestier privé, mon voisin de Camprieu et, tout particulièrement,
M. Pierre Rutten, également forestier privé. Je regrette davantage d’en
oublier d’autres à qui je demande de me pardonner une mémoire déclinante.
Mon inexpérience d’historien et ma connaissance, qui reste très
incomplète, de la forêt m’ont probablement fait commettre des erreurs. Je
remercie donc encore mais par anticipation, cette fois, tout lecteur qui
pourrait me signaler celles venant à sa connaissance. J’aurai peut-être
l’occasion de les rectifier. A
tous mes lecteurs possibles, je me permets de préciser que ceci ne prétend pas
être un mémoire scientifique, ce qui explique que je n’y ai pas fait figurer
mes sources – mais, sur ce point, je serai heureux de satisfaire, si je le
peux, d’éventuelles curiosités.
Camprieu, 20 juin 2000
Georges
VALDEYRON
Professeur honoraire de Génétique et Amélioriation des Plantes
à l'Institut National Agronomique Paris-Grignon
Illustrations
Le
plan de l’arboretum qui figure ici reproduit celui de l’excellente étude de
Francis Debazac, « L’arboretum de l’Hort de Dieu » parue dans
les Annales des Sciences Forestières ; Tome 21, fascicule 1, 1964.
Georges Fabre, notice nécrologique,
par Charles Flahault.
Depuis la réédition de cette notice, en Décembre 1997, on a cherché
à mettre davantage en lumière l’importance des travaux expérimentaux du
forestier et du botaniste. L’attention du lecteur est, à cet égard, attirée
sur l’article « Flahault et Fabre se sont-ils trompés ? »
paru dans la revue « Forêt Méditerranéenne »
t.XX, n°2, juin 1999. Est maintenant disponible un aperçu de la l’œuvre
scientifique spécialement sylvicole de Ch. Flahault, « Charles Flahault,
le jardinier du Jardin de Dieu », par G. Valdeyron, pour la lecture duquel
il est recommandé de se reporter à la présente brochure et, en particulier,
au paragraphe du bas de la page 12.